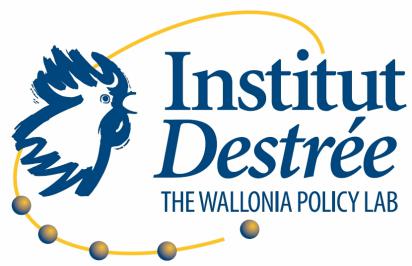> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v Les décideurs wallons face à leurs responsabilités
2021-25 - Namur, le 16 août 2021. > [pdf]
Déjà, avant les inondations de juillet qui ont frappé son territoire et ses habitants, la Wallonie présentait un bilan économique et social peu enviable : un taux de pauvreté très élevé, un chômage et un sous-emploi très importants, un niveau d’activité économique trop faible, des finances publiques déséquilibrées, un niveau de dette publique préoccupant. Cette situation ne date pas d’hier, elle perdure depuis plus de 30 ans.
Encore plus alarmant, les gouvernements successifs des 20 dernières années ont élaboré et mis en œuvre des plans de redressement sans que les conditions macro-économiques et macro-sociales ne se soient améliorées significativement sur cette période.
Malgré ce constat étayé par de nombreux et solides indicateurs, jamais un gouvernement ou un ministre n’a reconnu, endossé, ou même interrogé ces échecs évidents. Seul Elio Di Rupo, actuel ministre-président, a admis, dans une interview à "La libre" du 8 février, que ces différents plans pour redresser la Wallonie n’avaient pas obtenu les effets espérés, en attribuant ces échecs à "un manque de temps pour faire adhérer à ces plans un nombre important d’acteurs économiques et sociaux."
Et, à la lecture des rapports d’activité ou des déclarations des dirigeants des différentes institutions et organismes publics ou subventionnés impliqués dans la vie économique et sociale de la Wallonie – agence pour l’emploi (FOREM), centres de formation, agence à l’exportation (AWEX), outils financiers et d’investissement (Invests, SRIW, Sowalfin), administrations de l’économie, de l’emploi et de la R&D, agence du numérique, incubateurs, agences intercommunales de développement, pôles de compétitivité, cellules de valorisation des universités, réseaux d’enseignement, universités, hautes écoles, agences de formation en alternance, j’en oublie certainement –, tous disent accomplir un bon travail.
Mais alors, si tout le monde en Wallonie fait bien son métier, comment expliquer cette situation économique et sociale parmi les plus mauvaises au sein des régions européennes ? Vertigineuse question… Mais la solidité de la réponse dépendra de la solidité de l’hypothèse, à savoir que toutes les structures citées accomplissent au mieux leur mission.
Pour les entreprises du secteur privé, les faibles performances sont sanctionnées par le marché, conduisant à une baisse des profits, voire des pertes. Ces entreprises fragilisées sont alors obligées de réagir, sous peine de disparaître. Pour révéler la réalité des performances de structures qui ne sont pas soumises à un marché, il faut fixer des objectifs clairs, réalistes et réalisables, et procéder à des évaluations extérieures et approfondies. Pour nombre des organismes que nous avons cités, en dépit d’un "contrat de gestion" pour certains, les feuilles de route ne sont ni claires ni précises. Rares sont les évaluations dignes de ce nom, et encore plus rares les mesures de correction pour remédier aux faiblesses mises en évidence. Chacun peut donc se décerner tous les satisfecit qu’il juge mériter. Les incitations à l’efficacité et à l’efficience sont faibles.
Les inondations de juillet réclament avec d’autant plus de force la fin du laxisme qui prévaut en Wallonie dans la gouvernance des structures publiques, parapubliques ou subventionnées. La Région vient de connaître une des pires épreuves de son histoire alors qu’elle est déjà en position de faiblesse. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des populations déjà précarisées, ont tout perdu, leur logement et tous leurs maigres biens. Les services publics élémentaires sont suspendus dans bien des localités, ainsi que les moyens de communication (routes, ponts…). De très nombreuses entreprises sont empêchées d’activité. Effacer les graves séquelles de ce choc climatique qui a empiré une situation économique et sociale déjà alarmante prendra du temps et sera complexe, puisque la reconstruction devra intégrer un nouvel aménagement du territoire qui tiendra compte d’une éventuelle répétition de pareils phénomènes et des exigences du développement durable.
Le tout dans un contexte budgétaire très difficile. La dette publique wallonne, si elle est gérable aux niveaux actuels très bas des taux d’intérêt, va devenir un poids très handicapant pour l’action publique dans un horizon de 10 à 20 ans, au fur et à mesure qu’elle devra être renouvelée à des taux d’intérêt plus élevés.
Les autorités wallonnes, et toutes les structures qui en dépendent, sont, plus que jamais, face à leurs responsabilités. Plus que jamais, les plans de soutien et de reconstruction doivent être conçus avec rigueur, réalisme et ambition. Des objectifs doivent être clairement assignés aux opérateurs en charge de leur opérationnalisation. Les procédures de suivi et d’évaluation doivent être incluses dans les ordres de mission et les cahiers de charge. Ces procédures doivent être mises en œuvre dans les temps prévus et leurs conclusions doivent être appliquées sans faiblesse. A défaut, la Wallonie ne se remettra pas du désastre qui vient de la frapper et verra s’éloigner encore la perspective de retrouver une place parmi les régions prospères d’Europe.
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr