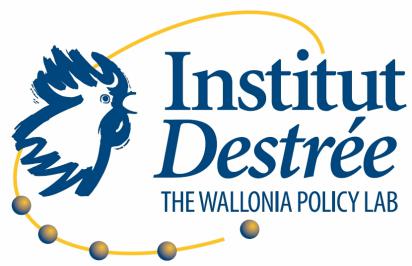> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v Quel système économique pour sauver la planète ?
2021-29 - Namur, le 13 septembre 2021. > [pdf]

Dreamstime - Green Business
Dans ma chronique du 23 août dernier (1), consacrée au rapport du GIEC et à l’avenir très douloureux que les changements climatiques préparent aux populations de la planète, je posais rapidement la question de la compatibilité de notre système économique – l’économie de marché (que les capitaux soient publics ou privés) – avec les objectifs de décarbonation de nos productions et consommations.
Dans une interview au journal "Le Monde" (2), l’ancien patron emblématique du géant industriel allemand Siemens, Joe Kaeser, très conscientisé aux enjeux du climat, aborde cette question et appelle à ce que nos économies de marché se transforment en des économies de marché sociales et écologiques. Il ajoute que les entreprises doivent en fin de compte servir la société, et non pas seulement les actionnaires et les clients, avec comme conséquence de ne plus considérer la maximisation du profit comme leur seul objectif.
On ne peut qu’applaudir. L’économie de marché doit se "moraliser" et son expansion permanente doit être maîtrisée, sans quoi les dommages les plus alarmistes vont se réaliser.
L’économie de marché se caractérise par la liberté laissée à chacun, producteur et consommateur, d’agir comme il le souhaite dans un cadre réglementaire et législatif donné. Longtemps, on a cru que la poursuite des intérêts particuliers, même fort peu louables comme l’appât du gain, servait l’intérêt général de développement et de bien-être. La citation célèbre d’Adam Smith - "Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt" - a longtemps servi de mantra aux zélateurs de l’économie de marché (3). La cupidité, la poursuite du profit et l’égoïsme de la réussite ont donc été élevés en vertu ou, du moins, étaient exempts de toute condamnation morale si les résultats découlant de ces motivations contribuaient à l’augmentation de la production des biens et services, quels que pussent être ces biens et services, utiles, inutiles, dommageables ou non.
La question est donc : est-ce réaliste d’envisager que les producteurs et consommateurs modifient leur comportement d’eux-mêmes ou doit-on opter pour une solution plus radicale : sortir de l’économie de marché ?
Cette solution extrême, pour séduisante qu’elle soit aux yeux de certains, pèche par un manque d’alternatives réalistes qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Par quoi remplacer l’économie de marché ? Nous n’avons, pour notre part, jamais trouvé une réponse satisfaisante et crédible. Mais le débat doit rester ouvert.
De même qu’il est peu probable que les incantations et les recommandations, même de grands industriels comme Joe Kaeser, changent les motivations des producteurs et les détournent de l’objectif de profit maximum, surtout dans les pays émergents comme l’Inde, la Chine, les autres pays asiatiques, et bientôt les pays africains. Dans ces pays où règnent pauvreté et misère, chacun voudra s’enrichir au plus vite, et les autorités auront tendance à laisser faire pour ne pas casser le mouvement de hausse générale du niveau de vie. Plus "existentiellement"", l’âme humaine est ce qu’on en a fait depuis la révolution industrielle, on ne la changera pas en une saison.
Il reste une troisième voie : encadrer l’économie de marché, comme un tuteur guide la croissance d’une plante, pour obliger l’adoption de nouveaux comportements, tout en s’efforçant de ne pas en briser la dynamique. Est-ce possible ? L’histoire montre que l’économie de marché a pu assimiler les grandes réformes sociales – augmentations salariales, salaire minimum, limitation du temps de travail, sécurité sociale, taxations… - sans aucun dommage notable sur l’efficacité du système, contrairement à ce qu’affirmaient les patrons de l’époque. On peut cependant noter que rien n’est jamais acquis : depuis que la mondialisation et les révolutions technologiques ont renforcé le rapport de force des détenteurs du capital à l’égard des salariés, le partage des richesses s’est modifié en faveur des propriétaires et les acquis sociaux sont durement contestés.
Néanmoins, peut-on intégrer les objectifs écologiques et climatiques dans l’économie de marché comme l’ont été les exigences sociales ? La réponse est probablement oui. Taxer progressivement mais massivement la production et l’utilisation des énergies fossiles, favoriser les développements des énergies renouvelables, obliger à une mutation plus rapide des biens de consommation tributaires des énergies fossiles (comme les voitures ou le chauffage), limiter par la taxation la partie nuisible du commerce mondial, toutes ces mesures et bien d’autres, l’économie de marché peut les absorber.
Cependant, hormis les protestations corporatistes des secteurs qui devront s’adapter, trois grands obstacles se dressent sur la route d’une production et d’une consommation plus durables. Le premier, encore une fois, est constitué par la réticence des pays émergents à prendre le risque de briser leur dynamique de bien-être. Les pays riches seront-ils capables de la solidarité indispensable pour aider ces pays à franchir le pas ? Le deuxième obstacle est le consommateur des pays économiquement avancés qui n’est pas prêt à changer ses habitudes, à accepter l’accès plus difficile (car plus cher) à certains biens et certains services (comme les voyages en avion), à devoir dépenser plus pour respecter certaines réglementations (comme l’isolation des bâtiments). Les autorités publiques auront-elles le courage d’affronter les citoyens déjà mécontents et très méfiants à l’égard du pouvoir politique ? Enfin la troisième grande difficulté : nombre des mesures visant à décarboner la planète vont frapper durement le pouvoir d’achat des classes déjà défavorisées. Des mécanismes compensatoires seront indispensables.
Le pessimisme que l’on peut éprouver sur la capacité du genre humain à éviter les drames climatiques futurs ne se nourrit pas de l’absence de solutions, ni d’une impossible mise au pas du système économique actuel mais bien de la volonté insuffisante des pouvoirs politiques et institutionnels à prendre rapidement les décisions indispensables.
Reste encore une question tout aussi fondamentale : l’économie de marché peut-elle continuer à fonctionner en limitant sa ponction des ressources naturelles à un niveau compatible avec le renouvellement de celles-ci ? Mais à chaque chronique suffit son sujet.
___________________
(1) https://www.institut-destree.eu/2021-08-23_chronique-economique_didier-paquot.html
(2) 3 septembre 2021
(3) Bien qu’authentique, cette citation est plus nuancée quand elle est remise dans le contexte de l’ensemble de la réflexion du père de la science économique moderne.
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr