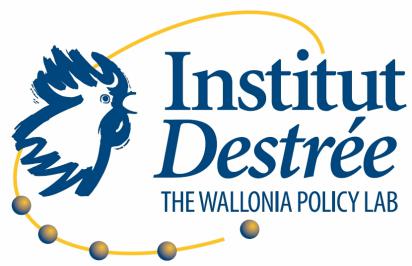> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v E-commerce, la Wallonie à la traîne (1)
2021-38 - Namur, le 22 novembre 2021. > [pdf]
Dans les manuels d’économie du temps – très reculé – de nos études, il était d’usage de distinguer les secteurs économiques "exposés" ou "ouverts", des secteurs "abrités" ou "protégés". La première catégorie regroupait les secteurs, principalement industriels, qui étaient exposés à la concurrence internationale, tant sur leur marché intérieur qu’à l’exportation. La seconde catégorie, en pure logique, incluait tous les secteurs (la construction, le commerce, l’éducation, les services à la personne, etc.) qui ne devaient craindre personne sinon leurs concurrents domestiques.
Cette distinction a eu, et a encore, une influence importante sur les politiques économiques des pays. On considère en effet que les exportations accroissent la richesse d’une nation (ce qui est vrai) et que les importations la diminuent (ce qui est en bonne partie faux (2)).
Les autorités politiques ont longtemps mené des politiques de subventions en faveur des secteurs exposés, jusqu’à ce que les règles du commerce international y mettent bon ordre. Encore maintenant, les subventions masquées, mais surtout les politiques d’amélioration de la compétitivité visent le même objectif. Quant aux secteurs protégés, ils étaient l’objet de moins d’attention. Qu’importe que ce soit Paul ou Jacques qui produise, puisque les revenus qu’ils engendrent ne s’échapperont pas à l’étranger.
Les choses ont bien changé durant les 20 dernières années. La frontière entre secteur "exposé" et secteur "abrité" est devenue de plus en plus poreuse. Par exemple, dans le secteur de la construction, la "libéralisation" des services et de la circulation des personnes amène une concurrence des entreprises de construction étrangères jusque dans nos villages.
Mais c’est surtout le secteur du commerce qui, avec l’apparition d’internet, a vu ses marchés s’ouvrir à tous vents. Le consommateur n’a plus besoin de se déplacer, il choisit les articles sur un site, il procède à un paiement électronique et la marchandise lui est livrée à domicile. D’où qu’elle vienne. L’habitude d’acheter en ligne fait tache d’huile. En 2019, 66% des consommateurs belges avaient procédé à un achat en ligne au cours de l’année écoulée (ils n’étaient que 55% 4 ans plus tôt), et seuls 18% d’entre eux n’avaient jamais commandé en ligne.
L’importance des achats en ligne varie fortement d’un pays à l’autre comme le montre le graphique suivant (dont la source est le "Center for Retail Search") :
Le tableau figure en taille réelle dans le fichier <pdf>
référencé sous le titre de la chronique
Alors que les achats en ligne atteignent près de 20% du commerce de détail au Royaume-Uni, ils ne comptent que pour à peine 4% en Italie. La Belgique se trouve en queue de peloton avec un peu moins de 9%. Mais on voit aussi que la progression est rapide, puisque la part du commerce en ligne a presque doublé depuis 2012. Et il n’y a aucune raison pour que cette progression s’arrête, au vu des chiffres des autres pays. C’est une tendance lourde dans le changement des comportements qui n’est pas prête de s’infléchir.
Qui dit commerce en ligne dit concurrence internationale, qui dit concurrence internationale dit lutte pour les parts de marché entre entreprises domestiques et entreprises étrangères. C’est bien ce que les statistiques montrent. Selon l’enquête TIC, ménages, individus du SPF économie (2019), 43% des individus belges ont commandé, au cours des 12 derniers mois, par internet, des biens et des services auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE. Et sur les consommateurs belges ayant commandé sur internet, 65% ont commandé, entre autres, auprès de vendeurs établis dans d’autres pays de l’UE, contre seulement 40% aux Pays-Bas, pays de taille similaire, et 35% pour l’ensemble de l’UE.
Clairement, une partie importante de la croissance belge de l’e-commerce échappe aux commerçants belges, et de manière plus importante que dans d’autres pays.
Qu’en est-il de l’offre d’e-commerce en Belgique ? Selon l’étude du cabinet-conseil RETIS sur l’offre en e-commerce en Belgique (3), fin 2020, la Belgique comptait environ 7.800 entités juridiques répertoriés comme e-commerçants. Il faut prendre ce chiffre avec précaution (sans doute une sous-estimation) car les commerçants ne renseignent pas toujours leur activité internet à la Banque Carrefour des Entreprises. Mais ce qui est important, c’est la constatation d’une augmentation de 45% des e-commerçants par rapport à l’année précédente. L’année 220 est sans doute exceptionnelle en raison de la crise COVID. Il n’empêche, le nombre d’e-commerçants a quintuplé entre 2010 et 2020.
Malheureusement, le contraste est marqué entre la Flandre et la Wallonie. Seuls 24% des e-commerçants belges se trouvent en Wallonie. On dira que c’est le poids de l’économie wallonne dans l’économie du pays. Mais l’évolution conte un récit plus inquiétant. En 2008, la proportion d’e-commerçants dans chaque région reflétait pratiquement la répartition de la population (soit 32% pour la Wallonie). L’écart s’est creusé entre 2008 et 2016, pour se stabiliser jusqu’en 2019, mais pour s’accroître encore en 2020.
Contrairement à d’autres secteurs, comme les secteurs industriels, cet écart ne trouve pas sa cause dans le poids du passé. Les deux régions partaient d’une feuille blanche. Force est de constater que le dynamisme numérique dans le secteur du commerce a été moindre en Wallonie.
Pourtant, depuis 2016, une action de formation à l’e-commerce (conjointe entre pouvoirs publics et, d’abord, la fédération professionnelle UCM, et puis le SNI (4)) est menée auprès des responsables d’entreprises. Si ces formations rencontrent un certain succès, on ne sait en revanche pas combien de ces entrepreneurs "formés" sont passés à l’acte. Trop peu si on se réfère aux chiffres de l’étude RETIS. En outre, comme le souligne cette étude, il faut non seulement que les commerçants existants se convertissent à l’e-commerce mais aussi (et peut-être surtout) qu’il y ait plus de nouveaux projets.
Malheureusement, l’esprit d’entreprise ne se construit pas à coup de subventions, c’est un travail de changement de mentalité de longue haleine. Il faut décidemment y travailler en Wallonie, ainsi qu’il ne faut pas ménager les efforts pour réconcilier les citoyens et les TPE avec le numérique. La Wallonie ne peut se permettre de rater cette révolution en cours. Or, certains doutes sont permis, comme en témoignent d’autres enquêtes comme le Baromètre 2021 de maturité numérique des citoyens wallons, publié par l’Agence wallonne du numérique (5). Voilà un enjeu qu’il faut traiter à la mesure de son importance pour l’avenir de la Wallonie, c’est-à-dire cruciale.
________________________
(1) Merci à Damien Jacob, fondateur du Cabinet RETIS, et à Hélène Raimond, expert senior à l’AdN, de m’avoir fourni de nombreuses informations.
(2) Il vaut en effet mieux importer certains biens à bas prix plutôt que de les produire chez soi à un coût élevé, et consacrer les ressources domestiques (travail, capital), épargnées grâce aux importations, à la production de biens où on est compétitif. C’est le fameux théorème de l’avantage comparatif que l’on doit au grand économiste anglais David Ricardo (1772-1823).
(3) https://www.retis.be/statistiques-secteur-de-commerce-belgique/
(4) UCM= Union des Classes moyennes, SNI = Syndicat Neutre des Indépendants.
(5) https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/citoyens2021
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr