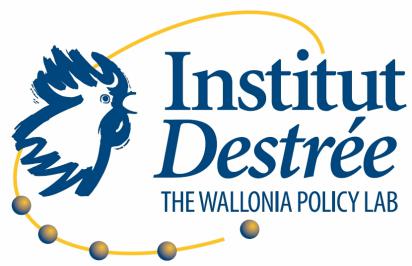> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v Les économistes sont-ils suffisamment écoutés par les politiques ?
2022-02 - Namur, le 17 janvier 2022. > [pdf]
C’est une complainte récurrente chez les économistes : les politiques ne les écoutent pas assez. Ou alors trop tard, comme l’ironisait cruellement John Maynard Keynes : "Les hommes pratiques qui se croient tout à fait exempts de toute influence intellectuelle, sont généralement les esclaves de quelque économiste défunt. Les fous d'autorité, qui entendent des voix dans l'air, distillent leur frénésie à partir d’un quelque scribouillard académique d'il y a quelques années" (1).
A ce reproche, les politiques rétorquent que, sur une interrogation économique, on peut récolter autant d’avis que d’économistes consultés, parfois tout-à-fait contradictoires et peu opérationnels. On ne peut nier une certaine vérité dans ces propos. Lorsqu’on demande aux économistes un avis panoramique sur les grandes questions macro-économiques ou même sociétales, les réponses versent vite dans les théories livresques ou une philosophie économique mâtinée de sociologie et de psychologie sociale.
Mais que les questions soient bien circonscrites et l’économiste peut éclairer le politique sur des enjeux structurels de grande importance, comme le chômage, les finances publiques, les échanges commerciaux, l’inflation, la pauvreté, le changement climatique etc.
L’économiste peut déjà faire un état des lieux suffisamment rigoureux pour que se dégagent de manière assez claire les interactions entre les facteurs, les causalités, et les effets qu’auraient certaines politiques sur ces phénomènes économiques : quelles mesures fonctionnent pour faire baisser le chômage et augmenter l’emploi, pour réduire le déficit commercial, pour atténuer la pauvreté, favoriser le redéploiement industriel, rétablir l’équilibre des finances publiques. Il y a certainement des divergences entre "écoles" économiques sur les politiques à mettre en œuvre, mais bien moins qu’on pourrait le penser, et du moins y aurait-il une certaines transparence à prévoir où telle ou telle politique économique veut mener l’économie d’un pays ou d’une région si sont déterminées, pour chacune d’elles, ses avantages, ses inconvénients, ses conséquences, ses risques.
Quelques économistes français ont ré-ouvert le débat à travers 3 tribunes publiées dans le journal Le Monde du 17 décembre dernier, dont les titres sont à eux seuls explicites : "A la présidentielle 2022, le risque d’un nouveau rendez-vous manqué entre économistes et politiques" (Hippolyte d’Albis, François Benhamou, André Cartapanis)(2), "Pourquoi les économistes sont-ils si peu écoutés par les candidats à la présidentielle 2022 ?"(3), (Emmanuelle Auriol) et, plus positif, "Pour peser sur les débats de la présidentielle 2022, les économistes disposent de trois principaux leviers" (Xavier Jaravel) (4).
Emmanuelle Auriol avance trois raisons pour lesquelles les économistes sont si peu écoutés. La première est "le déficit de culture économique", tant dans le public que chez les politiques. Si bien que les décideurs politiques ne réalisent pas combien la science économique pourrait battre en brèche les lieux communs (l’économiste de l’université de Toulouse prend l’exemple de la réduction du temps de travail) et leur éviter de prendre des mesures qui leur paraissent très logiques mais qui, en réalité, ne tiennent pas compte de la complexité des phénomènes économiques et aboutissent à des résultats parfois contraires à ceux escomptés.
La deuxième raison avancée est "la pression démocratique". Les électeurs veulent entendre des réponses simples et de court terme à des problèmes complexes qui demandent des politiques économiques de long terme. Pour assurer leur élection, les politiques donnent à la population ce qu’elle demande : "des solutions claires, simples mais fausses". La troisième raison est "la déréglementation du marché de l’information". Sur Internet et les réseaux sociaux, "toutes les idées sont en concurrence sans aucun filtre, ni processus de validation".
Les trois auteurs de la première tribune vont dans le sens d’Emmanuelle Auriol : obsédés par leur élection ou réélection, les politiques versent dans le simplisme et le court-termisme. Mais les auteurs rappellent tout de même que les économistes doivent aussi balayer devant leur porte : "Les économistes […] négligent trop souvent les effets de court terme [d’une politique de long terme], les coûts d’ajustement. […] Les raisonnements économiques n’intègrent pas les obstacles politiques pouvant survenir et s’opposer aux politiques économiquement optimales. […] Les économistes ont tort de ne pas suffisamment intégrer le faisceau de contraintes dans lequel s’exerce l’action publique en se limitant aux solutions optimales, sans définir le sentier permettant d’y parvenir, et en négligeant les opinions collectives, sources de blocages".
Personnellement, nous avions, il y a quelques années, sur les fonds propres de l’UWE, financé une étude très rigoureuse d’une équipe universitaire sur les aides à l’emploi. Les conclusions de cette étude avaient été balayées par les négociateurs syndicaux et gouvernementaux, parce que l’étude venait d’une association patronale, parce qu’il y avait une méfiance instinctive à l’égard de travaux universitaires trop complexes, et parce que les recommandations ne convenaient pas aux intérêts particuliers de chacun. Ont donc été mis en place des mécanismes financiers d’aide à l’emploi qui, à l’expérience, ont montré toute leur inefficacité.
Le Gouvernement wallon a eu recours, par deux fois lors de cette législature, à l’expertise d’économistes universitaires. D’abord pour l’élaboration du rapport "Get Wallonia", le plan de redressement de la Wallonie. L’expérience fut mitigée, parce que le rapport était trop vaste, qu’il ne tenait pas suffisamment compte des contraintes politiques. Il n’empêche que ce rapport présentait un diagnostic assez juste sur l’économie et la société wallonne, qui débouchait sur d’excellentes recommandations transversales qui ont été tout à fait ignorées.
La deuxième expérience est la mise en place par l’ancien Ministre wallon du budget, Jean-Luc Crucke, de la "Commission externe de la dette et des finances publiques", constituée de 8 économistes universitaires, et chargée de conseiller le Ministre sur la conduite des finances publiques wallonnes. Cette Commission a joué un grand rôle dans l’objectivation du déséquilibre des finances et de la dette publiques wallonnes, dans la prise de conscience que les dérives ne pouvaient plus durer et dans la proposition d’une mesure claire pour aller vers un rééquilibrage à moyen terme. Cette mesure est-elle suffisante ? Le débat peut se poursuivre mais au moins sur une base solide. En outre, le Gouvernement wallon, celui-ci et les futurs, ne pourra jamais dire qu’il ne savait pas. Le seul regret est que le rapport de cette commission n’ait pas été rendu public.
Nous sommes évidemment quelque peu juge et partie, mais les deux expériences de collaboration entre des économistes et le gouvernement wallon montrent que la consultation d’économistes peut faire gagner aux politiques publiques rigueur et solidité. Aux économistes, en retour, de prendre en compte les contraintes qui peuvent corseter l’action publique.
______________________________
(1) “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back”, The General Theory of Employment, Interest, and Money. Merci à Etienne de Calataÿ de m’avoir restitué la citation dans sa forme originale.
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr