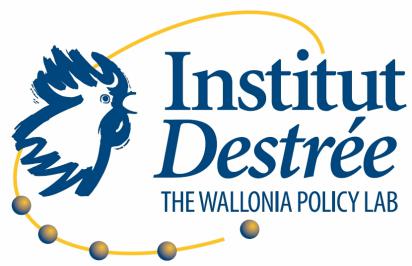> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v Quel entrepreneuriat pour le développement local ? (1)
2022-05 - Namur, le 7 février 2022. > [pdf]

© rawpixel.com
Le "Biopark" est présenté comme une des plus belles vitrines de l’activité bio-technologique de la Wallonie, comme un des symboles du renouveau économique wallon. Installé au nord de Charleroi, il abrite et soutient une vingtaine de start-ups biotech, des services d’essais cliniques, des laboratoires de recherche. En tout, 3.000 personnes y travaillent. Sur le site internet du Biopark on peut lire : "Le Biopark est ainsi devenu, au fil des années, un acteur majeur du développement socio-économique de la région de Charleroi (2)".
Pourtant, cette même commune de Charleroi présente un taux de chômage d’environ 15%, près du double de la Wallonie, et l’activité économique annuelle est 20% moins élevée que la moyenne européenne.
On pourrait refaire l’exercice d’un tel contraste dans d’autres villes où se sont développés des parcs scientifiques : Liège, Mons, Namur. Seul le Brabant wallon témoigne d’une cohérence entre le déploiement de ses start-ups et celui de son environnement économique. La province entière s’est, en effet, développée à partir d’un territoire vierge et sur la base de grandes entreprises innovantes, d’une université dynamique, d’une population aisée et très bien formée, ainsi que grâce à la proximité avec Bruxelles.
Mais quand il s’agit de redonner vie à des régions frappées par la désindustrialisation, les politiques entrepreneuriales centrées sur les start-ups technologiques ont un effet très marginal. Comme le relèvent deux professeures de management, S.Kim et A.Kim, dans un article consacré à ce sujet ( ), une récente revue de plus de 200 articles sur "entrepreneuriat et pauvreté" conclut que les initiatives entrepreneuriales visant à adresser le problème de la pauvreté par l’investissement à risque ("venture investment") ont été en général inefficaces. Le modèle de la Silicon Valley ne "prend" pas dans les localités "appauvries" ("impoverished").
Est-ce à dire que des régions en retard de développement doivent abandonner toute politique de soutien aux start-ups technologiques ? Evidemment non. Si ces start-ups ne parviennent pas à revitaliser des localités en perte de vitesse, elles vont créer ailleurs des zones de prospérité où elles vont s’y développer et, pour certaines d’entre elles, créer de l’emploi, beaucoup d’emplois, emplois cependant réservés à une certaine catégorie de la population, comme c’est le cas d’entreprises comme Odoo à Louvain-la-Neuve, I-Care à Mons ou Univercells à Charleroi.
Ces entreprises citées sont, pour l’heure, des exceptions dans le monde des start-ups wallonnes. La plupart d’entre elles sont encore de petite taille et le resteront, plus guidées par le rendement financier (voulu par leurs investisseurs) que par la croissance de l’emploi, par un développement à l’étranger plutôt qu’en Wallonie, par une cession très profitable plutôt qu’un ancrage dans le territoire.
En dépit de ces réserves, ces start-ups font beaucoup de bien à la région, elles élèvent et stimulent le niveau technologique qui se diffuse dans le reste du tissu économique, elles créent des emplois indirects, elles attirent des investisseurs étrangers, elles positionnent la Wallonie sur la carte européenne, voire mondiale, rendant la région attractive pour les investissements, cette fois de tous les secteurs. Et enfin pour devenir une grande entreprise, il faut d’abord avoir été petite. Nul ne peut dire, dans toutes ces start-ups, lesquelles, même si elles ne seront pas nombreuses, sont promises à créer de l’emploi dans la région.
Si il n’est pas indiqué d’abandonner le soutien à l’entrepreneuriat basé sur l’investissement à risque, il est aussi absolument nécessaire de soutenir un autre type d’entrepreneuriat qui, lui, aura un impact direct sur les territoires économiquement et socialement plus faibles, un entrepreneuriat centré sur les besoins et les ressources locales. Les autrices de l’article cité plus haut qualifie la dynamique de cet entrepreneuriat de"scaling deep", une croissance en profondeur, à l’opposé du modèle du premier entrepreneuriat qu’elles nomment "scaling up", une croissance en hauteur.
Selon S. Kim et A. Kim, l’entrepreneuriat basé sur le "scaling deep" est un entrepreneuriat qui répond aux besoins plus strictement locaux ou régionaux, qui ne repose pas sur des capitaux à risque venus de l’extérieur mais sur la combinaison des ressources qui sont déjà disponibles. Ces nouvelles entreprises grandissent en nouant des liens avec des partenaires locaux, elles engagent des personnes vivant dans leur proximité, elles s’ancrent dans le territoire local. Leur croissance est sans doute plus lente, mais peu importe puisque un rendement important n’est pas exigé par les investisseurs.
Ne nous méprenons pas, l’entrepreneuriat que définissent les deux autrices de l’article ne doit pas être confondu avec la démarche de la personne sans emploi qui devient indépendante en ouvrant un commerce ou en créant une petite activité de services. Ces démarches sont évidemment tout à fait honorables, mais on parle ici de créations d’entreprises dont l’objectif est ambitieux, qui veulent créer de la valeur et de l’emploi par l’innovation et, pourquoi pas, par la technologie, mais tout en répondant à des problèmes locaux ou régionaux.
En Wallonie, il existe beaucoup de structures (toutes efficaces ?) qui aident les personnes sans emploi à devenir indépendantes. Il en existe aussi beaucoup (sans doute trop et mal coordonnées) pour soutenir l’entrepreneuriat technologique et numérique. Mais qui apporte un soutien aux futurs entrepreneurs, pas nécessairement universitaires, pas nécessairement dans la précarité, mais porteurs d’idées de "business" qui revivifieront l’économie locale et régionale ? Sans doute est-ce la tâche des 6 "Centres européens d’entreprise et d’innovation" wallons, financés par les fonds structurels européens depuis plus de 20 ans.
Quel est le bilan de l’activité des CEEI sur ces 20 dernières années ? Nous n’avons pas trouvé de publications sur le sujet. S’il s’avère qu’aucun exercice approfondi d’évaluation n’a encore été mené, peut-être faudrait-il commencer par là pour donner une base solide à une stratégie cohérente de soutien à l’entrepreneuriat "scaling deep". La suggestion d’évaluation est d’ailleurs tout aussi valable pour les incubateurs qui soutiennent l’entrepreneuriat "scaling up".
____________________
(1) Mes remerciements, une fois de plus, à Marcus Dejardin, professeur à l’Université de Namur, qui m’a mis sur la piste de l’article à la base de cette chronique et m’a nourri de bien d’autres.
(2) https://www2.ulb.ac.be/biopark/entreprises.html
(3) Suntae KIM, Anna KIM, how entrepreneurship can revitalize local communities, Harvard Business Review, 2022.
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr