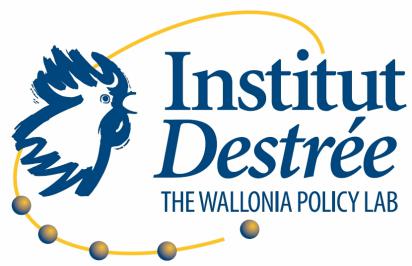> Chronique de la vie économique wallonne : le regard de Didier Paquot
v Finançons mieux nos universités (1), par la porte ou par la fenêtre
2021-31 - Namur, le 27 septembre 2021. > [pdf]
 Dreamstime - Iakov Filimonov
Dreamstime - Iakov Filimonov
Les universités constituent des atouts essentiels pour les économies industrielles dites avancées, dont le moteur principal est l’innovation. Leur apport est multiple. Elles forment les talents dont les entreprises ont besoin. Ce sont aussi principalement les universitaires qui assurent le renouvellement du tissu économique en créant et en faisant grandir les nouvelles entreprises innovantes. Bien souvent, l’activité même de ces nouvelles entreprises est le résultat de la R&D menée au sein de l’université, R&D qui fournit aux autres entreprises les connaissances nécessaires pour leur innovation.
Déjà temples du savoir humain et de l’enseignement, les universités sont donc devenues de véritables pôles économiques physiques qui rassemblent et attirent les entreprises d’avenir. Il suffit de voir les parcs d’activité (parcs scientifiques) qui se sont développés autour des 4 universités wallonnes. Ils accueillent non seulement les entreprises issues des universités mais aussi nombre d’entreprises, même étrangères, attirées par les qualités des universités, tant de formation que de R&D.
Le financement des universités est donc, pour un gouvernement (régional ou fédéral), un investissement qui paraît tout à fait approprié pour le développement de son territoire, et pas seulement sous l’angle économique (que nous venons de développer) mais aussi de manière plus sociétale, des universités plus performantes conduisant à une société plus instruite, plus génératrice de connaissances, avec la réputation internationale qui en découle. Ces arguments ne semblent pourtant pas convaincre les gouvernements régionaux (Wallonie et Bruxelles) et communautaire (Fédération Wallonie-Bruxelles) du monde francophone belge.
Nous avons déjà plaidé dans une précédente chronique pour un financement massif des projets R&D des universités francophones (2). Et nous avions soutenu que, si le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles n’avait plus d’argent, c’était aux gouvernements régionaux de prendre le relais, sans se soucier du découpage institutionnel des compétences.
Le raisonnement tient aussi pour les dépenses de fonctionnement, d’enseignement, et de R&D "général" des universités. D’abord le constat. Depuis la rentrée 1998-1999, le financement des universités se fait à "enveloppe fermée", c’est-à-dire que le budget n’est adapté qu’en fonction du coût de la vie, et non plus en fonction de l’évolution de la population estudiantine.
Comme le nombre d’étudiants augmente significativement et constamment (il est passé d’un peu plus de 60.000 pour l’année académique 2000-2001 à plus de 97.000 pour l’année 2016-2017 (3)) et que l’enveloppe est restée à peu près la même en euros constants sur cette même période, le financement par étudiant a, de manière purement arithmétique, été diminué de 22% (toujours à prix constants) entre 2000 et 2017, selon les calculs de Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de l’Université Saint-Louis (4). Une autre estimation, menée par le CERPE de l’Université de Namur (5), aboutissait au chiffre de 15% entre 2008 et 2017.
Si on maintient cette enveloppe budgétaire "fermée", cette baisse ne fera que s’aggraver. En effet, selon toute probabilité (et il faut le souhaiter), le nombre d’étudiants universitaires va encore augmenter dans l’espace francophone belge. En effet, le taux des personnes 30-34 ans qui détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur est de 40% en Wallonie, alors qu’il évolue (à l’exception notable de l’Allemagne et l’Italie qui présentent des taux plus bas) entre 45% et 54% dans les autres pays de la zone euro (6).
Justement, au regard des autres régions ou pays, le système universitaire francophone belge est-il mal financé ? Selon l’étude du CERPE, en 2016, le financement public total par étudiant universitaire est, dans la Fédération-Wallonie, inférieur de 9% à celui de la Communauté flamande, de 51% à celui des Pays-Bas et de 7% à celui de l’Allemagne.
L’estimation du recteur honoraire Lambert, pour l’année 2017, diffère sensiblement puisque les dépenses publiques par étudiant dans l’enseignement supérieur sont, en fédération Wallonie-Bruxelles, 29% inférieures à celles de la Flandre, 10% à celles de l’Allemagne et 39% à celles des 4 pays nordiques européen. Par contre, elles sont supérieures de 2% à celles des Pays-Bas.
Les différences méthodologiques (par exemple, la première étude s’attache aux seules universités tandis que la seconde englobe la totalité de l’enseignement) et des sources statistiques (les financements de l’enseignement supérieur sont très complexes à définir, de par la structure particulière que prend cet enseignement dans chaque pays et par la variété des sources de financement) expliquent sans doute ces divergences dans les résultats. Mais, hormis pour les Pays-Bas où les tendances vont en sens opposé, toutes les estimations convergent vers le même constat : les universités belges francophones sont moins bien financées que leurs consœurs étrangères.
La détérioration continue de la situation financière des universités francophones est connue depuis longtemps, les recteurs ne manquent pas une occasion pour la rappeler. Mais les autorités publiques font presque la sourde oreille, presque parce que, de temps à autre, des budgets sont ajoutés pour tenter de calmer les esprits.
Et pourtant, n’est-ce pas le devoir de tout gouvernement d’assurer le meilleur enseignement possible à sa jeunesse, surtout quand ces efforts sont économiquement récompensés par plus d’activités innovantes, plus de dynamisme, plus d’attractivité internationale, et donc plus de recettes fiscales ?
On nous dit : les finances de la fédération Wallonie-Bruxelles sont à sec. Mais les gouvernements régionaux doivent-ils se cacher derrière cette excuse pour ne rien faire, alors que les citoyens de la Fédération sont évidemment les mêmes que ceux des régions, ce que le découpage institutionnel tend à masquer ? Ce sont donc leurs propres citoyens que les gouvernements régionaux pénalisent.
Comme refinancer les universités ? Par l’absorption des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles par les régions ? Par des transferts budgétaires ? Aux politiques de s’accorder. Ces nouveaux financements doivent-ils s’accompagner de plus d’exigence envers les universités ? Certainement. Il n’en reste pas moins qu’aucun obstacle ne justifie que les régions obscurcissent leur avenir, déjà pas très brillant, en restant insensibles au sort de leurs universités.
____________
(1) Cette chronique se concentre sur une partie de l’enseignement supérieur, l’université, et laisse dans l’ombre les hautes-écoles. Celles-ci connaissent pourtant les mêmes difficultés, peut-être de manière moins aigüe. Il était simplement difficile de traiter l’ensemble de l’enseignement supérieur dans une même chronique, d’autant que nous étions en possession de moins d’études sur les hautes-écoles. Mais ce qui est dit pour les universités vaut aussi, mutatis mutandis, pour les hautes-écoles.
(2) https://ww.institut-destree.eu/2020-10-26_chronique-economique_didier-paquot.html
(3) Les données ne sont pas toutes fraiches mais ce sont les seules disponibles.
(4) J-P. LAMBERT, Ampleur et effets de la dégradation du financement de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, in Dynamiques régionales n°11, IWEPS, 2021
(5) M.POURTOIS, sous la direction de H. Bogaert, Etude comparative du financement public des universités en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, CERPE, Janvier 2019
(6) source: Eurostat.
> Inscrivez-vous par mail à cette chronique économique :
economics [at] institut-destree.eu Bienvenue
> Partagez aussi cet article avec vos réseaux :
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr