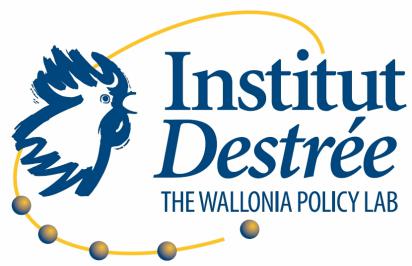v Education permanente de la Communauté française Wallonie - Bruxelles
L'Institut Destrée est reconnu comme service général d'Education permanente par la Communauté française Wallonie - Bruxelles. L'équipe de l'Institut Destrée travaille sur des chantiers liés à plusieurs domaines de compétences : recherche, société de l'information, prospective et citoyenneté. Construits en partenariats, ils se concrétisent par des séminaires, des colloques, des conférences et des publications (articles, livres, CD, DVD).
Les documents présentant les dossiers concernés pour l'année 2015 sont proposés ici :
v Analyse 1
Philippe DESTATTE,
Quatre principes d'action pour concrétiser l'économie circulaire
19 janvier 2015,
15.687 signes.
Le 19 janvier 2015 s’est tenue, au Palais des Congrès de Namur, une journée d’étude sur le thème ambitieux de « L’économie circulaire, le passage à l’acte », organisée par Deloitte Belgique, Deloitte France, Wallonie Développement et l’Institut Destrée. Au terme de la rencontre, Philippe Destatte a abordé quatre transversalités qui ont, parmi d’autres, traversé les préoccupations de la journée : articuler les initiatives suivant le principe de subsidiarité ; mobiliser l’ensemble des acteurs privés et publics autour de stratégies collectives pertinentes ; placer les entreprises et les citoyens au coeur des dispositifs ; travailler par chaines de valeur, par filières en même temps que par métabolismes. L’économie circulaire, c’est davantage du sur-mesure que du prêt-à-porter. Philippe Destatte conclut son intervention sur trois observations.
Il faut placer l’économie circulaire là où elle doit être. On ne rendra pas service à l’idée en laissant penser que l’on créera « naturellement » une multitude d’emplois ou qu’on rendra « automatiquement » ses lettres de noblesse à la croissance grâce à l’économie circulaire. Par contre, on peut faire de cet outil un facteur de mobilisation complémentaire au travers d’une stratégie régionale d’économie circulaire qui activera les compétences régionales et les mobilisera aux niveaux territorial local et entrepreneurial. Au delà du grand intérêt et des qualités certaines du guide de l’ADEME, il y a un manque flagrant d’une étape de visionning, comme souvent dans les travaux stratégiques et prospectifs français. Même si le guide évoque la vision des acteurs, il ne précise pas suffisamment l’importance et la nécessité d’une étape qui fixe l’horizon des attentes et les finalités de la stratégie et des actions, ce bien commun, ce bien de la collectivité. L’économie circulaire, l’innovation et la créativité font partie du même ensemble : celui de la renaissance industrielle au sens large, de ce que j’ai appelé ailleurs « le Nouveau Paradigme industriel », qui allie, comme on le fait en prospective, approche globalisante, écosystémique, vision de long terme ainsi qu’action volontariste et concrète. La mise en place de l’économie circulaire demandera, n’en doutons pas, des efforts incommensurables, une mobilisation longue et de chaque instant, le renforcement de tous nos dispositifs d’action, une nouvelle gouvernance qui soit tout le contraire de molle, c’est-à-dire un cadre public très décidé, très volontariste, très contraignant.
v Analyse 2.
Philippe DESTATTE,
Quelle désindustrialisation pour quelles mutations industrielles
11-16 mars 2015,
66.756 signes.
Désindustrialisation, réindustrialisation, mutations industrielles, renaissance de l’industrie : depuis le milieu des années 2000, les territoires, les États, les continents du vieux monde atlantique résonnent de ces leitmotive porteurs d’inquiétantes rumeurs associées aux discours déclinistes, à la perte des capacités commerciales et à l’effondrement des marchés Philippe Destatte rappelle qu’un nouveau récit se développe autour de l’industrie qui vit des mutations au croisement du numérique et de l’écologie. Ce récit qui interroge la question de la désindustrialisation pointe souvent l’Europe en la rendant responsable d’un désintérêt à l’égard des manufactures et des usines, au nom d’une évolution qualifiée d’hypothétique vers des sociétés de l’information ou de la connaissance. Philippe Destatte montre que, dès les années 1990, notamment avec le Livre blanc sur la compétitivité et l’Emploi de la Commission Delors, les politiques européennes s’étaient appuyées sur l’idée d’un ajustement structurel pour construire une politique industrielle dans un environnement, certes ouvert et concurrentiel, mais fondé à la fois sur l’axe des avantages compétitifs de la dématérialisation de l’économie et sur celui du développement industriel durable valorisant la production allégée d’énergie et de matières premières. Dans son dialogue avec le Conseil et les États membres, la Commission a fait évoluer son rapport à la désindustrialisation de l’Europe, notamment sous les effets de la crise de 2007-2008 sur la compétitivité européenne. Dans ce cadre, 2012 constitue certainement un tournant et 2014 une accélération au travers de l’idée de renaissance industrielle européenne, vue non pas comme un retour à un ordre ancien mais comme une accélération des axes de développement définis dans la capitale européenne depuis le Livre blanc sur la Compétitivité et l’Emploi. La difficulté pour l’Europe – comme du reste pour les États membres, leurs régions et leurs territoires –, c’est de mettre en conformité les discours pour une réindustrialisation vigoureuse et les actes, sous la forme de mise en oeuvre au jour le jour de plans d’actions crédibles.
v Analyse 3.
Michaël VAN CUTSEM,
L'innovation territoriale, théorie et pratiques
mai 2915,
8.268 signes.
Smart cities, économie circulaire et de la fonctionnalité, hub créatifs, livings labs, e-tourisme… On assiste, en Wallonie et ailleurs en Europe, à un foisonnement de concepts qui viennent pertinemment questionner les modèles économiques et d’organisation dans lesquels interagissent les territoires et les entreprises au 21e siècle. Après un bref tour d’horizon des initiatives témoins de la recherche d’un nouveau souffle par nos modèles économiques, Michaël van Cutsem pointe deux initiatives concrètes d’application de ces nouveaux concepts économiques aux secteurs et métiers du tourisme : la mise en place du Green Hub, hub créatif de la province de Luxembourg, et celle du Hackathon.
v Analyse 4.
Philippe DESTATTE,
Le Cœur du Hainaut, un territoire en transformation
12 mai 2015,
10.423 signes.
Trois transitions sociétales ont structuré le Coeur du Hainaut du XIXe au XXIe siècles : d’abord, la Révolution industrielle, ensuite la transition vers le développement durable et enfin, la Révolution cognitive que nous vivons actuellement. Ce texte constitue la conclusion de l’analyse intitulée Transitions et reconversions dans le Coeur du Hainaut depuis la Révolution industrielle, qui a fait l’objet d’une communication au colloque de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, le 28 mars 2015, à la Faculté polytechnique de Mons. On a dit jadis, dans des milieux wallons qui leur voulaient du bien, que le Borinage et le Centre demeuraient les terres brûlées de l’économie belge. En 1958, les chercheurs de l’Institut de Sociologie de l’ULB mettaient en discussion le concept de sous-développement économique quant à son application au Borinage. Ils en déduisaient qu’en dernière analyse, le problème borain est un problème de structures vieillies ou périmées. Depuis 1961, sinon 1835 pour le Borinage, ce qu’on appelle aujourd’hui le Coeur du Hainaut est à la recherche d’un nouveau souffle. Inscrit dans ce Nouveau Paradigme industriel qui allie sociétés industrielles, développement durable et Révolution cognitive, le Coeur du Hainaut construit son redéploiement et prépare sa réindustrialisation en s’appuyant sur l’économie numérique et sur le GreenTech, l’économie du développement durable. Dans son discours sur l’état de la Wallonie du 25 mars 2015, le Ministre-Président Paul Magnette indiquait que la Wallonie avait arrêté de décrocher. Ce qui est peut être vrai pour la Wallonie ne l’est pas pour le Coeur du Hainaut, en tout cas si on se
base sur l’évolution du PIB par habitant des trois arrondissements de référence de cet espace : ceux de Mons, de Soignies et de Charleroi. Néanmoins, si l’érosion s’y poursuit dans les statistiques, les conditions du redéploiement sont aujourd’hui réunies.
v Analyse 5.
Philippe DESTATTE,
Liège, au cœur de la reconversion industrielle wallonne
28 mai 2015,
24.059 signes.
Juste avant 1960, et l’accélération de son déclin, au moment où José Sporck la décrivait avec tant de minutie, la Région industrielle liégeoise, composée de 64 anciennes communes, d’Engis à Visé, ou de Hermalle-sous-Huy à Lixhe, était structurée par ce que le géographe économique appelait quatre activités caractéristiques, qui occupaient près de 80 % de la main-d’oeuvre totale de cet espace, et révélait une personnalité industrielle remarquable. Derrière une série de compartiments homogènes articulés mais différenciés, Sporck identifiait surtout le poids déterminant et considérable des industries des métaux, du charbon, des industries verrières, ainsi que des industries chimiques minérales dépendant essentiellement des deux premières. Tout au long de son travail, le jeune chercheur liégeois ne cachait pas les difficultés présentes et à venir de la zone, parmi lesquelles le vieillissement de l’industrie et la localisation des entreprises nouvelles étaient des problèmes centraux. On sait le sort que l’histoire du demi-siècle qui a suivi a réservé à ces quatre activités caractéristiques. Et les transformations que la carte de 1957 a pu subir. Philippe Destatte fait un tour d’horizon des principales initiatives prises, entre 2003 et 2013, afin d’assurer le redéploiement du bassin liégeois. Celui-ci se trouve maintenant à une bifurcation, c’est-à-dire ce moment où, plusieurs voies étant possibles, il s’agit de choisir la meilleure. La réaffectation économique des sites sidérurgiques désaffectés constitue une occasion unique de prendre cette voie. Les ateliers lancés par le GRE-Liège, depuis le début 2015, et intitulés Industries du futur 4.0., sont en train de donner du contenu à la démarche de reconversion. En activant des acteurs de premier plan – scientifiques, créateurs, entrepreneurs et organisateurs ensemble –, autour d’idées innovantes d’abord, de priorités crédibles ensuite, de projets de plus en plus concrets, enfin, les Liégeois nous donnent une leçon de dynamisme stratégique. L’union et l’articulation des forces de l’Université, de l’intercommunale de développement, de poids lourds politiques, le soutien tangible de la Région wallonne et le leadership assumé par des entrepreneurs de premier plan au travers du GRE donnent à l’ensemble une réelle force de frappe dont les effets doivent maintenant se traduire sur le terrain. Liège est véritablement au coeur de la reconversion industrielle wallonne.
v Analyse 6.
Marie DEWEZ,
Le numérique pour l'inclusion sociale : une association possible ?
15 juin 2015,
42.951 signes.
En avril 2015, s’est tenu un colloque, organisé par la députée et sénatrice louviéroise Olga Zrihen, avec la participation d’Ecole numérique et de Technofutur TIC, consacré à la fracture numérique. Dans son article, Marie Dewez entend revenir sur les interventions et débats entendus pendant cette journée et poursuivre la réflexion sur les thématiques abordées. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont des compagnons permanents de notre vie. Si leurs avantages, pour ceux qui en maitrisent l’usage, ne sont plus à démontrer, force est de constater qu’elles peuvent également engendrer l'exclusion et être sources de vulnérabilité pour ceux qui n’en connaissent pas le fonctionnement ou qui n’y ont tout bonnement pas accès. La fracture numérique, plus qu’une ligne de rupture purement symbolique, porte donc en elle les germes d’une fracture plus large et globalisante, celle de la fracture sociale, et nous devons la combattre. Dans une première partie, Marie Dewez se penche sur les TICE. Dans l’enseignement de la Communauté française, l’utilisation des NTIC est encore marginale ; leur usage en classe reste exceptionnel, alors qu’elles peuvent être un vrai plus dans l’apprentissage de l’élève. Diverses initiatives ont toutefois été lancées afin de favoriser leur utilisation et leur intégration dans la classe, notamment la mise en place dans les écoles d’Espace numérique de Travail, le projet École numérique, le Passeport TIC. Dans une deuxième partie, Marie Dewez fait le point sur les jeunes en décrochage, que l’on regroupe sous l’étiquette NEETs. Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? Combien sont-ils ? Quel est l’impact de ce phénomène chez nous, en Wallonie, mais aussi en Europe ? Comment l’expliquer ? Elle aborde enfin l’initiative Espaces publics numériques lancée par le Gouvernement wallon, en 2007, pour lutter contre l’exclusion numérique, et particulièrement le projet EPN pour les NEETs, dû à la collaboration de Technofutur TIC et du Forem, dont l’objectif est de toucher les NEETs en vue de les faire réintégrer le marché du travail ou de la formation.
v Analyse 7.
Philippe DESTATTE,
Valoriser la localisation de la province de Luxembourg dans la Grande Région
17 juin 2015,
20.146 signes.
Le séminaire organisé par l’intercommunale IDELUX à Heinsch (Arlon), le 10 juin 2015, avait pour objectif d’aborder la question des retombées de la métropole luxembourgeoise pour le développement économique du territoire et de s’interroger sur le positionnement stratégique des institutions qui oeuvrent dans ou pour la province du Luxembourg wallon.Après être revenu sur l’essentiel des débats entendus lors de cette rencontre, Philippe Destatte formule deux observations et deux suggestions pour favoriser le développement territorial luxembourgeois wallon :
- Un modèle métropolitain plus complexe : Tant le modèle métropolitain luxembourgeois que le processus de développement de la Grande Région se complexifient et montrent leurs limites stratégiques mais aussi politiques. Cette évolution nous invite à perdre nos naïvetés un peu simplistes, à aborder autrement ces deux objets, et à remettre en question nos stratégies héritées du passé.
- Une province mieux intégrée à la Région : La Wallonie et la province de Luxembourg sont en transformation profonde. Elles s’intègrent l’une et l’autre progressivement, trop lentement encore, pour faire naître et vivre de nouveaux objets : pôles de compétitivité, clusters, filières, hubs, organes comme l’ARES, tandis que certains secteurs, comme les Biotech ou l’agroalimentaire, confirment leur poids et y performent. Ainsi, la province de Luxembourg interagit aujourd’hui mieux qu’hier avec la Wallonie.
- Rechercher le prochain train d’innovation : L’innovation réside dans notre capacité à identifier quels seront les prochains moteurs de notre attractivité et de notre compétitivité territoriales. Pour briller dans la course, nous devrons identifier les prochains moteurs avant le reste du monde et les faire fonctionner plus rapidement.
- S’articuler à la Régions et aux voisins : Si je suis bien entendu convaincu que la dimension territoriale est celle du redéploiement économique, du travail concret, du renforcement de l’attractivité et de la compétitivité, avec les acteurs et en particulier les entreprises, sous l’égide des intercommunales de développement, des chambres de commerce, etc., je pense aussi que cette dimension de proximité n’est pertinente que pour autant qu’elle s’articule à l’ensemble de la Région et aux compétences que celle-ci active.
v Analyse 8.
Philippe DESTATTE,
La Wallonie : une gouvernance démocratique face à la crise,
15 septembre 2015,
29.499 signes.
Ce sont l’intérêt de l’analyse des régions européennes que sont l’Andalousie, le Pays de Galles, la Bretagne et la Wallonie, la problématique majeure de la vision partagée qui peut sous-tendre l’avenir de ces régions, ainsi que les enjeux de gouvernance et de leadership politiques, qui ont permis de réunir une centaine d’acteurs et de chercheurs au Palais des Congrès de Namur, le 11 septembre 2015 !
Philippe Destatte est intervenu en clôture des débats. L’objectif de son intervention n’est évidemment pas de refaire une deuxième synthèse des travaux après celle réalisée par Christian de Visscher. Son positionnement est plutôt celui d’un rebond, qui se veut questionnement et ouverture, davantage que conclusion.
Lors de cette journée, il a nourri trois questions, trois enjeux qui lui paraissent déterminants pour la Wallonie :
– comment assumer la responsabilité collective du développement régional ?
– comment réactiver le redressement de la Wallonie ?
– comment donner davantage de cohérence institutionnelle à notre région ?
v Analyse 9.
Philippe DESTATTE,
Prospective et développement territorial : retour sur quelques ambiguïtés,
8 octobre 2015,
26.013 signes.
Ce texte constitue l'occasion d'éclairer les rapports entre développement territorial, développement durable et prospective, en relevant l'importance de l'analyse des systèmes territoriaux d'innovation comme passage entre aménagement du territoire et développement territorial, ainsi que leur proximité avec la prospective. La contribution permet de mettre en évidence plusieurs ambiguïtés de la prospective, notamment son caractère normatif, et d'aborder quelques difficultés de la gouvernance territoriale en général et celle de la gouvernance wallonne en particulier, en se référant à la révision du SDER lors de la
législature 2009-2014.
v Analyse 10.
Michaël VAN CUTSEM,
CREAT, une anagramme de TRACE,
8 octobre 2015,
14.709 signes
Cinquante années, c’est le temps de l’enfance, de l’adolescence et de l’entrée dans l’âge adulte de l’aménagement du territoire wallon. Cette politique publique, devenue progressivement discipline académique et scientifique a ouvert un champ d’investigation large que l’on peut appeler le développement territorial. Dans cet article, Michaël Van Cutsem propose de baliser les acteurs, les concepts, les documents qui ont fait l’histoire de cette discipline, en mobilisant des ressources volontaires qui seraient prêtes à alimenter un wiki collaboratif consacré au développement territorial.
v Analyse 11.
Philippe DESTATTE,
La Wallonie et la France, 70 ans après le coup de semonce de 1945,
12 octobre 2015,
26.952 signes.
En octobre 2015, l’Alliance Wallonie-France a souhaité commémorer le Congrès national wallon des 20 et 21 octobre 1945, soixante-dix ans après sa tenue, et a invité Philippe Destatte à venir évoquer cet événement majeur de l’histoire de la Wallonie. Philippe Destatte a livré une analyse en trois regards – celui de l’historien, du Wallon et du citoyen – qui s’articulent entre passé, présent et avenir. En tant qu’historien, le directeur général de l’Institut Destrée revient sur le Congrès national wallon, lui-même, événement qui polarise véritablement la demande wallonne en matière d’autonomie dans le contexte fondamentalement dramatique qui est celui de la sortie de la guerre 1940-1945, ainsi que sur les positions sur lesquelles le congrès aura à se prononcer : le maintien de la structure unitaire de la Belgique avec des modifications plus ou moins importantes dans l’appareil constitutionnel ou légal ; l’autonomie de la Wallonie dans le cadre de la Belgique ; l’indépendance complète de la Wallonie ; la réunion de la Wallonie à la France. Philippe Destatte fournit ensuite une analyse du présent. De 1945 au milieu des années 1960, sous les effets conjugués de son absence de dynamisme, d’innovation, d’autonomie, de créativité, de volonté de redéploiement, la Wallonie a poursuivi son déclin. Actuellement, malgré les contrats d’avenir et les plans dits Marshall, nous nous maintenons sur un palier, mais nous stagnons. Nous nous redéployons, mais nous ne décollons pas. Cette responsabilité est collective : elle résulte de nous tous. Sa conviction est donc qu’il faut changer de trajectoire et construire l’avenir autrement. En tant que citoyen et démocrate, Philippe Destatte affirme que l’avenir est à construire maintenant. L’idée de réunion de la Wallonie à la France lui paraît une alternative crédible, mais il émet quatre réserves. En conclusion, si demain ou après-demain, comme on doit l’anticiper, à défaut de le craindre, la Belgique venait à disparaître, il nous faudrait choisir d’autres alternatives. Mais si c’est la France, ce sera la France libre.
v Analyse 12.
Marie-Anne DELAHAUT,
Novembre 2015,
16.694 signes
Par cette analyse, Marie-Anne Delahaut revient sur des textes et événements historiques fondamentaux et met en lumière l’action de personnalités féminines et féministes remarquables d’hier et d’aujourd’hui afin de montrer à quel point ce combat pour l’égalité des femmes et des hommes, est aujourd’hui encore, d’actualité. En effet, comme l’ont montré les travaux de Millennia2025, il s’agit d’un enjeu majeur de la
société du XXIème siècle, tant pour les femmes que pour les hommes. L'ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, créée en juillet 2010, estime que 35 % des femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles : à cet instant précis, environ un milliard et soixante-quinze millions de femmes et de filles ne bénéficient pas de leurs droits humains ni de l'autonomisation requise pour vivre libres conformément à la Déclaration universelle des droits humains ! Ce problème n’est pas nouveau et dès 2011, la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation a inscrit l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes dans sa Charte.
v Analyse 13.
Philippe DESTATTE,
L'avenir du développement durable : une vraie éthique de la responsabilité,
4 novembre 2015,
21.875 signes.
L’honnêteté, qui génère la confiance, ou l’absence d’honnêteté, qui fait perdre cette confiance, sont aujourd’hui, pour Philippe Destatte, au coeur de la problématique du développement durable. Et de son avenir. C’est ce qu’il s’est attaché à montrer au travers de deux exemples, vécus personnellement – le scandale Volkswagen-Audi, une expérience de la malbouffe dans une entreprise labellisée durable et innovante,
censée favoriser les produits locaux – pour en tirer quelques principes et pistes concrètes. Revenant sur le Rapport Brundtland, qui préconise la recherche de l’harmonie, c’est-à-dire une combinaison heureuse entre les éléments d’un système qui fait que ceux-ci concourent au même effet d’ensemble lui permettant d’atteindre ses finalités, Philippe Destatte prolonge la réflexion. Selon lui, l’avenir du développement durable réside dans sa capacité de se transformer, au delà des objectifs internationaux, des directives et des règlements, en une conscience commune et partagée, en une morale qui prévale sur les petits bénéfices, les tricheries médiocres et les tromperies malsaines. Une vraie éthique de responsabilité qui restaure la confiance des femmes et des hommes dans un être humain, un citoyen plus honnête, parce que davantage conscient qu’en contribuant au progrès de la trajectoire commune, il assume la survie de ses enfants et petits-enfants. Et, accessoirement, la sienne.
v Analyse 14.
Philippe DESTATTE,
À propos de quelques révolutions industrielles contemporaines,
9 novembre 2015,
37.537 signes.
Cette analyse constitue la mise au net, développée, de l'introduction de la conférence, Révolutions et transitions industrielles dans le Coeur du Hainaut (XIX-XXIèmes siècles), donnée par Philippe Destatte, dans le cadre de l'Extension de l'UMONS, Cycle Révolutions. Dans une période dans laquelle où nous proclame une nouvelle révolution industrielle de manière quasi-annuelle, il est bon de se souvenir que le changement n'est pas une finalité... Philippe Destatte revient sur les sens donnés à l’expression « Révolution industrielle », en rappelant les travaux des grands théoriciens dans ce domaine. Philippe Destatte apporte également un éclairage sur les vagues de transformations qu’ont connues le XXe et le XXIe siècles. Ses observations lui permettent d’affirmer que ce n’est pas la technique qui fait le futur, mais les hommes et les femmes. C’est d’eux que vient toute transformation de la société.
v Analyse 15.
Philippe DESTATTE,
Les perspectives d'une Wallonie autonome,
21 novembre 2015,
26.045 signes
Ce texte constitue la mise au net du discours prononcé par Philippe Destatte, le 21 novembre 2015, au Parlement de Wallonie à l'occasion du 75ème anniversaire du mouvement Wallonie libre et du 70ème anniversaire du Congrès national wallon de 1945. Par cette intervention, Philippe Destatte éclaire les perspectives d'une Wallonie autonome, à partir de quatre acceptions du concept d'autonomie : l’autonomie vue comme la condition d'une personne ou d'une collectivité politique qui détermine elle-même la loi à laquelle elle se soumet, comme la prise en compte des volontés individuelles, l’indépendance matérielle ou individuelle, enfin comme la distance que peut franchir un véhicule sans être ravitaillé en carburant. En conclusion, Philippe Destatte rappelle la nécessité de se montrer pragmatiques, c’est-à-dire de se poser les questions pertinentes et de se saisir concrètement des problèmes, sans a priori idéologiques, mais en prenant en compte le bien commun. Ce n’est que de cette façon que l’on pourra résoudre les questions qui se posent encore toujours actuellement.
v Analyse 16.
Philippe DESTATTE,
Le Front national est un parti fasciste,
11 décembre 2015,
16.692 signes.
Dans cet article, Philippe Destatte démontre par le biais de l’Histoire que considérer que le Front national est un parti fasciste permet de décrypter avec pertinence son succès populaire, d’expliquer pourquoi – sans surprise – il couvre l’ensemble du spectre électoral et donc de comprendre la raison pour laquelle il recrute des adhérents tant parmi les classes moyennes que dans les anciens bastions de la classe ouvrière, c’est-à-dire au sein des populations qui vivent aujourd’hui un sentiment d’abandon par rapport au socialisme ou au communisme qu’ils ont soutenu jadis. Des Führer et des Duce ont captivé les foules par leurs discours rassembleurs, leurs solutions semblant couler de source et soi-disant citoyennes à des crises qui affectent la France comme l’Europe et le monde. Ni plus, ni moins. Dans l’urgence de situations difficiles, les citoyens se sont laissé séduire par ce qu’ils ressentaient comme des paroles proches de leurs préoccupations, semblant induire les changements qu’ils espéraient. Personne n’a le droit d’oublier ces dures leçons de l’histoire de l’humanité. Au contraire, rappeler les dérives sournoises et dramatiques du fascisme, prévenir les citoyennes et citoyens d’aujourd’hui afin de protéger la démocratie pour les générations futures constitue un devoir. Les valeurs de la France libre, « liberté, égalité, fraternité », sont à ce prix. Ce n’est pas là faire preuve de morale ou de mémoire. C’est se souvenir de l’histoire comme connaissance et comme choix de trajectoire.
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique

Photo d'entête : Yves Goethals, Congrès "Bifurcations", Namur, 04.12.2018. (c) Institut Destrée, Droits SOFAM
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr