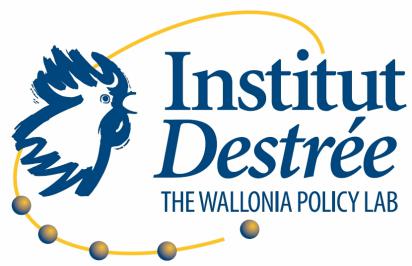v Education permanente de la Communauté française Wallonie - Bruxelles
L'Institut Destrée est reconnu comme service général d'Education permanente par la Communauté française Wallonie - Bruxelles. L'équipe de l'Institut Destrée travaille sur des chantiers liés à plusieurs domaines de compétences : recherche, société de l'information, prospective et citoyenneté. Construits en partenariats, ils se concrétisent par des séminaires, des colloques, des conférences et des publications (articles, livres, CD, DVD).
Les documents présentant les dossiers concernés pour l'année 2014 sont proposés ici :
v Analyse 1
Philippe Destatte,
Les mots pour le dire : SDER et autres SRADDT...
21 janvier 2014, 13.609 signes.
Au moment où communes et acteurs wallons se penchent sur le Schéma de Développement de l’Espace régional wallon (SDER), nous jugeons utile de revenir sur l’importance des mots utilisés pour parler du développement territorial. Qu’est-ce qu’un territoire ? Comment définir le SDER ? Qu’est-ce qu’un bassin de vie ou une communauté de territoires? Qu’entend-on par la notion de développement endogène, de cohésion territoriale? Autant de questions qui ont fait ou font toujours l’objet de discussions et auxquelles cette analyse entend apporter une réponse – non sans rappeler les principaux acteurs du débat – afin d’éviter toute ambiguïté guettant chercheurs et acteurs et d’aider à la compréhension du projet de révision du SDER.
v Analyse 2
Philippe Destatte,
Transition énergétique et « stratégies subversives »
30 janvier 2014,
21.665 signes.
Ce texte est le cadre de notre intervention aux Quinzième Assises nationales de l’Energie dans les collectivités territoriales, organisées par la Communauté urbaine de Dunkerque, en étroite collaboration avec Energy Cities, l’association européenne des autorités locales en transition énergétique. Dans cette analyse, nous exprimons sept convictions quant à la transition que nous vivons actuellement. Cette mutation, entamée dès les années 1960, qui nous fait passer de sociétés dites industrielles dans lesquelles nous sommes ancrés depuis le XVIIIe siècle, vers des sociétés cognitives, est systémique : c’est un véritable changement de civilisation et pas une simple vague d’innovations au sein de la société industrielle. Il nous faut absolument anticiper l’avenir, en construisant des visions prospectives et en mettant en place des stratégies répondant aux enjeux de long terme que nous identifierons. Le développement durable, tel qu’il est défini dans le rapport réalisé pour les Nations Unies, en 1987, par l’ancienne Première Ministre norvégienne, Gro Harlem Bruntlandt – rapport Bruntlandt – est une réponse fondamentale aux enjeux de l’avenir. La problématique énergétique constitue un élément essentiel de la transition que nous vivons, mais pas uniquement. Celle-ci porte, en effet, sur plusieurs autres pôles, notamment le temps, la vitesse de l’information et le vivant. La période actuelle porte ses propres interrogations sur le monde, qui sont des interrogations sur le temps. Et celui-ci ne joue pas en notre faveur. Dès les années 1960, nous avons pris conscience des limites de la planète, de ses ressources et de notre croissance en tant qu’espèce, sans pour autant changer véritablement de cap. Le défi de la transition est titanesque. Le besoin de métamorphose de la société et le nécessaire changement de nos comportements s’imposent aujourd’hui à nous comme des évidences et nous invitent à l’action. Les territoires sont les lieux concrets de l’action. Ils ne pourront s’inscrire dans l’avenir que grâce à des changements de comportements industriels et citoyens.
v Analyse 3
Philippe Destatte,
Les conditions d'un redéploiement de la Wallonie
16 février 2014,
16.439 signes.
Giuseppe Pagano, brillant économiste, vice-recteur au développement institutionnel et régional de l’Université de Mons, et Vincent Reuter, administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises, ont donné une intervention sur les politiques mises en place en vue du redéploiement de la Wallonie, lors d’une soirée organisée à l’Université de Namur par le Forum financier (FOFI) de la Banque nationale. Partant du constat partagé que la Wallonie va mieux mais qu’elle ne va pas bien, les deux interlocuteurs ont présenté les plans stratégiques du gouvernement wallon (Horizon 2022) et de l’UWE (Ambition 2020), rappelant la nécessité d’inscrire le redéploiement de la Wallonie dans des politiques de long terme. Les interventions de ces deux intellectuels, ici décryptées et nuancées, sont une bonne occasion de se pencher sur les conditions du redéploiement de la Wallonie. La transition de la Région wallonne vers une croissance intelligente, durable, inclusive et créatrice d’emplois, ne sera en effet pas aisée et si la construction et la
mise en œuvre de plans stratégiques structurés sont salutaires, elles restent toutefois fondamentalement insuffisantes. Pour assurer les conditions du redéploiement de la Wallonie, plusieurs changements
profonds s’imposent : réformer les institutions dites francophones, renforcer et rendre leur liberté au Parlement et à l’Administration et remettre la société en mouvement vers un but commun, en l’impliquant dans ce redéploiement.
v Analyse 4
Philippe Destatte,
18-19 mars 2014,
57.736 signes.
« Les bassins de vie sont des couillonnades qui ne reposent sur rien : je ne veux pas savoir qui les a inventés ! ». Ainsi Hervé Hasquin, secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, concluait-il sont discours prononcé à la salle académique de la Faculté Warocqué, lors de la soirée inaugurale de la réflexion lancée par le Collège provincial du Hainaut et l’Université
de Mons sur les territoires en Wallonie ainsi que sur la place de la province dans la gouvernance supralocale. Si la formule est emportée, la question est pertinente : quel est donc le couillon qui a inventé les bassins de vie ? Dans une première partie, nous tentons une réponse en abordant quelques origines des bassins de vie comme espaces d’observation. Dans une seconde partie, nous nous penchons d'avantage sur les espaces d’action, en nous reposant la même question. Cette analyse est l’occasion de regarder dans le rétroviseur et de rappeler le contexte dans lequel a pu naitre le concept de bassin de vie, les débats autour de cette notion et de sa définition ainsi que les initiatives prises en Wallonie en vue de concrétiser l’idée de bassin de vie. Il est difficile d’identifier un seul acteur, une seule trajectoire, un moment et un lieu. Les bassins de vie n’ont pas émergé subitement en Wallonie, dans le courant des dernières législatures. L’idée est donc complexe et profonde et dépasse largement nos frontières et notre siècle. Mais il est certain que si l’on a jusqu’ici défendu la pluralité des définitions et des espaces, la stabilisation des territoires et des institutions est une nécessité démocratique absolue. Leur simplicité est la condition même de leur compréhension, de leur appropriation ainsi que de la qualité des réponses que ces territoires et institutions apportent aux citoyens.
v Analyse 5
Philippe Destatte,
La Province, au cœur du débat sur les territoires
28 mars 2014,
17.286 signes.
Quelle organisation des territoires sera, demain, la plus profitable au citoyen ? C’est la question que nous avons posée, en clôture du colloque « Terrains, territoires et territorialités : la Province au cœur du débat ?, organisé à la salle académique de l’Université de Mons par le Collège provincial du Hainaut et l’Université de Mons. Nous avons identifié trois conditions pour que l’organisation des territoires soit, demain, profitable aux citoyens. L’organisation des territoires, demain, la plus profitable aux citoyens, sera celle porteuse de sens et de légitimité. Les territoires doivent être des « bassins d’envie », plus que des bassins de vie, c’est-à-dire qu’ils doivent davantage se nourrir de la volonté des acteurs et des citoyens de participer à un projet commun que d’un sentiment d’appartenance dont on surestime d’ailleurs constamment l’importance. Ainsi, pour être légitimes, ils devront être porteurs d’une volonté des acteurs locaux qui en font partie et moteurs des tâches et compétences qui leur seront confiées. La deuxième condition pour que l’organisation des territoires demain soit plus profitable aux citoyens, c’est qu’elle soit lisible et transparente. Les territoires doivent donc être stables et disposer de frontières établies, constantes et fixes. Nous identifions également trois niveaux infrarégionaux – à savoir, le communal, celui du bassin de vie et celui de l’espace provincial – auxquels seront attribuées diverses compétences par les communes et les acteurs, ainsi que par la Région et d’autres institutions. La troisième condition pour que l’organisation des territoires demain soit plus profitable aux citoyens, c’est qu’elle soit cohérente et efficiente. Cohérence et
efficience trouveront leur fondement dans trois variables interdépendantes. La première, la répartition et la coordination des compétences, qui devront être opérées de manière décrétale et tenir compte de la capacité à rencontrer les enjeux. La deuxième, la qualité des services, qui est fondamentale et assure une véritable légitimité. La troisième, le financement des services, qui peut être organisé de différentes manières, notamment pas des mécanismes de contractualisation avec la Région, le Fédéral et l’Europe, mécanismes complexes, mais les plus orientés vers les besoins concrets des citoyens, des entreprises et des autres acteurs. Enfin, une question majeure s’impose : que voulons-nous faire ensemble ? Car « si on a une volonté d’avancer sur les projets, on n’aura pas trop de difficultés à se mettre d’accord sur les institutions ».
v Analyse 6
Philippe Destatte,
L'Université de Wallonie pour pousser jusqu'au bout la logique de mutualisation
14 avril 2014,
15.897 signes.
Le Conseil des Recteurs des Universités francophones de Belgique a publié un texte dans lequel il déplore le définancement des universités wallonnes et bruxelloises qui doivent faire face à des conditions de plus en plus difficiles pour assumer leurs trois missions que sont l’enseignement, la recherche ainsi que le service rendu à la société. Après plusieurs années d’hésitations politiques, de réticences administratives et d’affrontements entre établissements pour réformer structurellement l’Enseignement supérieur, dix ans après le décret Bologne de mars 2004, la Communauté française n’est toujours par parvenue à stabiliser la structure de cet Enseignement. Des efforts de rapprochement entre les universités sont tout de même perceptibles, grâce notamment au décret Paysage du 6 novembre 2013, voulu par le ministre Jean-Claude Marcourt, créant l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES), qui joue un rôle extraordinaire d’intégration des pôles académiques, des universités, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts ainsi que des établissements de promotion sociale. On voit dans cette initiative la préfiguration d’un nouveau modèle, celui d’une seule Université de Wallonie. Le modèle qui s’est développé à l’Université du Québec, depuis plus de quarante ans, pourrait inspirer notre réforme du monde universitaire. Ainsi, l’Université de Wallonie se constituerait de six pôles géographiques (l’Université de Wallonie à Mons, Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve, Namur et Bruxelles). Le FNRS serait intégré dans cet ensemble comme un département de coordination et de financement de la recherche de la nouvelle institution, dont les droits et les pouvoirs seraient exercés par l’Assemblée des Gouverneurs, composée du président de l’Université, des recteurs de chacune des universités constituantes, des
représentants de la communauté universitaire et de huit personnes qualifiées nommées par le Gouvernement wallon – quatre personnalités étrangères de renom et quatre personnalités du monde de la recherche privée et des affaires. Cette Université de Wallonie répondrait au double enjeu de proximité et d’excellence. Avec la prochaine législature, le transfert à la région de la compétence, l’ouverture
aux acteurs et l’accroissement de l’autonomie, tous les ingrédients sont réunis pour former la base d’un meilleur développement de nos universités et hautes écoles au sens large. Il faut pousser jusqu’au bout la logique de mutualisation de l’Enseignement supérieur pour construire l’Université de Wallonie.
v Analyse 7
Philippe Destatte,
Quatre portes à ouvrir pour optimiser l'action publique
4 mai 2014,
17.959 signes.
La contraction annoncée des finances publiques constitue un enjeu majeur pour de nombreux territoires et régions. Les mois qui suivront le 25 mai en Wallonie vont probablement imposer un tournant majeur dans les politiques publiques. Le risque est grand de voir les dépenses faire l’objet de logiques de pure rationalisation plutôt que d’optimisation stratégique. Cette dernière, pourtant, tend à créer les meilleures
conditions de fonctionnement des services pour atteindre les finalités de l’action publique ainsi que les objectifs stratégiques et opérationnels qui y sont liés. Ainsi l’optimisation de l’action publique peut s’enclencher par l’ouverture de quatre portes. Celle de la compréhension par les fonctionnaires de leur rôle dans la société et de leurs missions est aujourd’hui centrale. La reconnaissance des acteurs et des
compétences révèle et valorise le travail de chacun. La confiance nait de l’adéquation des moyens et processus de la mise en œuvre avec les objectifs et les tâches des stratégies qui sont confiées à l’acteur concerné et se gagne aussi par la formulation d’un mandat clair. Le Lean Management, la gestion optimisée, appliquée à la fonction publique, permet de renforcer les ressources, mais aussi de changer de
centre de gravité dans le système : l’Administration est au cœur du système politique et étatique, en amont pour la préparation de la décision et en aval pour sa mise en œuvre. L’évaluation – conçue comme un processus d’apprentissage collectif destiné à construire une analyse – des politiques publiques, de l’action et du fonctionnement de l’administration augmente l’imputabilité. Le Lean Management, qui a fait son entrée dans les administrations nationales et fédérales, suscite l’intérêt des élus et de la fonction publique régionale et territoriale. La démarche vise l’optimisation par plus de participation, car aucune organisation ne peut se passer de l’investissement de ses membres, ainsi que l’optimisation vers plus d’intelligence. Elle « doit se comprendre comme un projet global et sur le long terme visant à placer les personnels au centre du dispositif afin d’imposer le travail intelligent au sein de collectifs à construire de toutes pièces ».
v Analyse 8
Philippe Destatte,
L'économie circulaire : produire plus avec moins
1er juin 2014,
21.906 signes.
Si le concept de ce qu’on appelle aujourd’hui l’économie circulaire apparait très récent, il s’inscrit dans une tradition qui remonte aux années 1970 avec le développement de l’analyse des systèmes, la prise de conscience de l’existence de la biosphère et des écosystèmes ainsi que le métabolisme industriel. Mais c’est véritablement aujourd’hui qu’il revient en force, après quelques nouvelles décennies de dégradation de notre biosphère et environnement de proximité. On entend par économie circulaire, une économie qui contribue aux finalités du développement durable en élaborant des processus et des technologies tels qu’elle substitue à un modèle de croissance dit linéaire, trop consommateur de ressources (matières premières, énergie, eau, foncier) et trop producteur de déchets, un modèle de développement écosystémique, parcimonieux en prélèvements naturels, pauvre en résidus, mais à la performance équivalente voire accrue. Si les approches et les priorités sont parfois très différentes, en nature comme en intensité, selon les pays, et qu’au sein même des pays et des régions, le sens que l’on attribue à l’économie circulaire est très varié et porte sur des activités et des processus plus ou moins étendus, on peut suivre l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie qui intègre ses pratiques à l’économie circulaire : l’écoconception, l’écologie industrielle, l’économie de la fonctionnalité, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage. L’économie circulaire apparaît comme un axe de développement majeur qui s’articule du global au local et fonde des politiques, systémiques et transversales, qui se mènent aux niveaux européen, national/fédéral, régional et territorial. Ces politiques ont vocation à s’emboîter, s’articuler, en devenant de plus en plus concrètes au fur et à mesure qu’elles se rapprochent des agents de terrain, et donc des entreprises.
v Analyse 9
Philippe Destatte,
Songe d'un tondeur solitaire : une roadmap pour les pilotes de la Région wallonne ?
9 juin 2014,
14.383 signes.
À l’issue du scrutin de mai dernier, nous avons pensé à la mission qui attend les formateurs du prochain gouvernement et réfléchi à une feuille de route en sept propositions destinée à construire un programme pour le Gouvernement wallon et son administration. Ainsi, que ferions-nous si nous étions pilote de la Région wallonne ? Nous commencerions par affirmer notre volonté de rupture et de changement structurel par rapport à ce qui a précédé, en rappelant les enjeux majeurs auxquels la Wallonie est confrontée dans son nécessaire redéploiement. Nous affirmerions que le Parlement wallon est le cœur de la démocratie régionale et qu’il doit être le lieu fort et le symbole de l’intérêt général. Nous constituerions un conseil de redéploiement avec une trentaine de membres des forces vives, destiné à recenser les « tabous
wallons » et à préparer un nouveau contrat d’avenir. Nous élargirions la majorité au Parlement wallon et à l’assemblée de la Communauté française et au groupe linguistique francophone de la Région de Bruxelles-Capitale, de manière à pouvoir disposer de la majorité requise (2/3) pour transférer les compétences nécessaires au redéploiement des régions. Nous définirions une stratégie globale, cohérente et
transversale visant à réaliser le maximum de concentration financière sur ce qui est véritablement estimé prioritaire dans la phase de reconversion, avec les moyens et les ressources actuels de la Région wallonne et ceux provenant des transferts de compétences. L’Administration wallonne jouerait le premier rôle auprès des ministres, qui seraient limités à sept, et les membres des Cabinets à 10 par ministre,
quel que soit l’ampleur des compétences. Enfin, nous nous donnerions cinq ans pour transformer considérablement la Wallonie de telle sorte que les habitants pourraient reprendre confiance en eux-mêmes, en leurs forces vives et en leurs élus, un engagement qui doit également être celui des ministres du Gouvernement wallon. Ainsi, la Wallonie a besoin d’une ou d’un ministre-président et d’une équipe de
ministres et de collaborateurs aussi respectueux qu’attentifs au travail du Parlement, qui aient à cœur de replacer l’Administration wallonne d’abord, les acteurs de la gouvernance ensuite, au cœur de l’action publique. La mise en place d’un contrat sociétal pour la Wallonie s’impose, sans quoi la société née pour assurer l’égalité de dignité de tous les êtres humains et les émanciper, pourrait devenir la société de
l’humiliation.
v Analyse 10
Philippe Destatte,
Vers une nouvelle génération administrative en Wallonie
7 juillet 2014,
20.890 signes.
En prolongement du colloque consacré à L’excellence opérationnelle dans les services publics, qui s’est tenu à Namur le 11 juin, nous identifions diverses pistes concrètes pour une nouvelle génération administrative en Wallonie, de la commune à la Région, l’essentiel étant que l’Administration et les pouvoirs publics redeviennent la locomotive de la société qu’ils ont toujours été. La démarcation entre le monde politique, l’Administration et l’entreprise n’est pas aussi forte qu’on le croit. Nous sommes tous les actionnaires d’une Wallonie s.a., c’est-à-dire profondément concernés, impliqués dans l’avenir d’une collectivité
politique, d’une collectivité humaine. Le reconnaitre vraiment aujourd’hui, en Wallonie, serait une réelle avancée. Il faut reconnaitre l’Administration comme un acteur à part entière et l’élu comme le maitre des horloges, ayant l’Administration comme premier partenaire et meilleure alliée. Il est également nécessaire de s’assurer de la faisabilité et du réalisme de la mise en œuvre des programmes dans le temps de la législature. Un travail stratégique en amont est nécessaire pour déterminer les priorités, les objectifs précis, calculer les rythmes, les temps et les budgets. Il s’agit encore de rendre les agents et les décideurs, y compris politiques, responsables. C’est se remettre en question, s’interroger sur ses processus, avoir un regard distancié sur ce que l’on fait et sur la manière dont on le fait, dans une logique d’amélioration ou de maintien du niveau de qualité. Les changements attendus sont des changements dans la culture, qui vont prendre du temps, qui sont générationnels. La volonté de changement doit donc partir des
acteurs eux-mêmes. La contraction budgétaire que vont connaitre les pouvoirs publics constitue une remarquable occasion de réinterroger l’ensemble du système.
v Analyse 11
Philippe Destatte,
Le (con)fédéralisme en Belgique n'est pas un problème, c'est une solution
14 juillet 2014,
23.555 signes.
Le fédéralisme n’est pas un problème, c’est une solution. Pour répondre aux questions concernant l’évolution du fédéralisme en Belgique et sa pertinence pour faire face aux tensions entre les populations qui composent le pays, il faut nécessairement aborder la question de l’ambiguïté. Question centrale puisqu’elle détermine la manière dont on comprend les mots, les concepts et les idées, crée de l’incertitude et déstabilise la compréhension du système. Le concept d’ethnie n’a plus sa place dans le cadre d’une discussion portant sur l’avenir de la Belgique. C’est un mot du passé et on ne peut construire l’avenir avec
les mots du passé. Actuellement, domine plutôt un modèle construit sur la citoyenneté, une transformation d’un modèle vers un autre, qui s’opère à cause de la supériorité du modèle républicain et de la diversité culturelle des populations. L’ambiguïté existe aussi dans les concepts de fédéralisme et de confédéralisme et la forme que prennent fédération et confédération comporte des variantes multiples selon le temps et les lieux. Mais quand on construit des institutions, importe, plus que leur nom, leur utilisation concrète comme outils destinés à améliorer le bien-être des citoyens et à renforcer l’harmonie du système dans sa totalité. En Belgique, le fédéralisme s’est déployé de manière progressive depuis le début des années 1970. Couramment qualifié de « Sui generis » et de « centrifuge », il a amélioré les relations entre les Flamands et les Wallons et rendu possible l’émergence d’une « collectivité politique » à Bruxelles et dans la communauté germanophone. Il a également permis que chaque région, avec ses compétences,
soit responsable de son avenir. Mais le système fédéral belge comporte également sa part de fragilité, qui réside dans sa bipolarité, c’est-à-dire dans la confrontation en face à face entre les Flamands et les francophones, encore renforcée par l’idée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une alternative serait une vision polycentrique construite autour de quatre régions ou communautés-régions – basées sur les quatre régions linguistiques – recevant toutes les compétences résiduelles non attribuées à l’État fédéral. Quoiqu’il en soit, l’essentiel est que ce (con)fédéralisme – quel que soit le terme utilisé – reconnaisse les autres en vue d’un dialogue réel et positif afin d’équilibrer les besoins d’autonomie, de coopération, d’association, de transparence, d’autonomisation, de cohésion sociale et surtout de démocratie et qu’il n’oublie
jamais que nous faisons partie de l’Union européenne, qui oriente fortement l’avenir de notre État fédéral et de ses institutions.
v Analyse 12
Philippe Destatte,
Un gouvernement wallon pour les 40 ans de la Région (1974-2014)
20 juillet 2014,
21.515 signes.
C’est le 20 juillet 1974 que fut voté à la Chambre, après le Sénat, le projet de loi visant la création des institutions préparatoires à la régionalisation, la loi PerinVanderkerckhove. 40 ans plus tard, le 22 juillet 2014 s’inscrira probablement dans l’histoire comme la mise en place d’un nouveau gouvernement wallon dans le cadre d’une réforme de l’État à mettre en œuvre et dans un environnement budgétaire
difficile. L’occasion est toute donnée de regarder dans le rétroviseur pour revenir sur cette étape-clé de l’histoire de la Wallonie, sur les personnalités qui y ont œuvré et leurs actions. Cette loi fixe provisoirement les limites des Régions, parmi lesquelles la Région wallonne – qui comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur ainsi que de l’arrondissement administratif de Nivelles – et dote chaque région d’un Conseil régional et d’un Comité ministériel des Affaires régionales. Chacune des trois Régions doit également recevoir une dotation financière de l’État central. Cette loi leur permet de déterminer elles-mêmes leur politique dans les domaines de l’expansion économique régionale, de l’emploi, de la santé, de l’eau, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la politique foncière, du logement, de la politique familiale et démographique, de la santé publique et de l’hygiène, de la politique industrielle et énergétique, du tourisme et de la politique d’accueil, de la chasse, de la pêche, des forêts, de l’organisation communale et de la politique de l’eau. Le 25 novembre 1974, se réunit pour la première fois à Namur le Comité ministériel wallon, sous la présidence du social chrétien Alfred Califice; le lendemain, le nouveau Conseil régional wallon, composé des sénateurs de Wallonie, tient sa première séance, à Namur également. Plusieurs personnalités se sont montrées particulièrement actives, dans la mise en œuvre de cette régionalisation, parmi lesquelles le libéral Jean Gol, alors secrétaire d’État à l’Économie wallonne. Pointant la nécessité d’un grand projet wallon, il est l’auteur d’un rapport sur le redressement wallon, une liste d’actions à mettre en place dès qu’un pouvoir wallon sera créé, qu’il présente en mars 1977. Ce que les membres de ce premier exécutif, né de la réforme du 20 juillet 1974, ont
réalisé en moins de trois ans est impressionnant. Allant vers une certaine forme de fédéralisme, les pionniers de l’Exécutif et du Conseil régional wallons de l’époque ont prouvé – dans un contexte économique et social extrêmement difficile qui peut rappeler celui d’aujourd’hui – que, dans l’adversité, c’est la qualité des femmes et des hommes, leur volonté de transformer la société et de mobiliser autour d’eux
l’innovation et la créativité, qui peuvent faire la différence.
v Analyse 13
Philippe Destatte,
Les entreprises et les territoires, berceaux de l'économie circulaire
25 juillet 2014,
21.325 signes.
Au delà des grands principes de développement durable auxquels l’économie circulaire contribue, s’inscrire dans sa dynamique c’est porter des politiques qui, du global au local, deviennent de plus en plus concrètes au fur et à mesure qu’elles se rapprochent des entreprises. L’économie circulaire, et en particulier l’écologie industrielle, s’inscrit depuis plusieurs décennies dans la réalité des entreprises, des zones d’activités économiques ainsi que des territoires. Elle connait une certaine montée en puissance depuis plusieurs années. Ainsi, la Commission européenne a proposé, fin 2005, une nouvelle stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets qui définisse une approche à long terme. Plusieurs propositions ont émané de cette stratégie, notamment une révision de la directive-cadre
relative aux déchets. La nouvelle directive annonce l’incorporation de la notion de cycle de vie dans la législation européenne. Depuis 2011, la stratégie Europe 2020, qui compte sept initiatives-phares, en comprend une intitulée « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources ». En Wallonie, la Déclaration de Politique régionale 2009-2014 a marqué la volonté de son gouvernement de favoriser la coopération entre les petites entreprises via notamment des groupements d’employeurs ou l’organisation des activités économiques en économie circulaire ainsi que d’intégrer et développer l’écologie industrielle dans la stratégie de l’ensemble des acteurs concernés (par exemple les sociétés régionales et intercommunales de développement économique) de telle sorte que l’on tende peu à peu vers une
optimisation des flux entrants et sortants (énergie, matières, déchets, chaleur, etc.) entre entreprises voisines. Cette volonté a été mise en œuvre l’année suivante dans le Plan Marshall 2.vert. C’est dans ce cadre que le gouvernement a lancé un appel à projets pour développer les éco-zonings, avec un budget de 2,5 millions d’euros, destiné à développer cinq expériences pilotes. En juillet 2013, le Gouvernement wallon a confié une mission déléguée à la Société régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW), et plus particulièrement à sa filiale BEFin, pour la création et la mise en œuvre de l’axe multisectoriel transversal « économie circulaire » de la politique industrielle wallonne (NEXT), complémentaire aux pôles de compétitivité. Ce programme a pour mission d’assurer le déploiement structuré, global et
cohérent de l’économie circulaire en Wallonie de façon à développer des projets porteurs de valeur ajoutée en se basant sur trois piliers : l’industrie, l’enseignement supérieur et un réseau international. Concrètement, il s’agit d’intensifier et de structurer le soutien aux projets innovants en matière d’économie circulaire portés par les entreprises wallonnes, en s’inscrivant dans une perspective de gestion durable des matières. L’expérience du terrain, notamment en Cœur du Hainaut, a montré que les seules réalisations tangibles sont celles qui se fondent sur le partenariat de proximité entre les acteurs et la confiance de long terme entre les entreprises et les opérateurs locaux. L’économie circulaire est surtout une affaire d’entreprises et de territoires, c’est-à-dire d’acteurs physiques et moraux rassemblés sur un espace par nature délimité et restreint.
v Analyse 14
Philippe Destatte,
Entre peur et confiance, le modèle des comportements wallons
4 août 2014,
21.325 signes.
En novembre 2004, un cercle de réflexion de trente personnalités provenant d’horizons différents s’est constitué, à l’initiative de l’Institut Destrée, avec pour volonté de réfléchir aux moyens de lever les obstacles qui continuent à affecter le développement en Wallonie. Ce Collège régional de Prospective s’est construit un modèle d’analyse, qui est régulièrement utilisé, comme grille de lecture par ses membres dans leurs propres travaux, mais qui suscite également l’intérêt des personnes extérieures. Partant du constat de la cohabitation de deux Wallonie avec deux systèmes culturels – celle de l’ancienne vision industrielle, qui n’en finit pas de se replier et de souffrir, et celle du renouveau, qui progressivement prend la place de la première – et après avoir identifié treize obstacles majeurs au développement wallon, le Collège régional
de Prospective a élaboré deux modèles, l’un des comportements wallons inadaptés, l’autre des comportements wallons souhaitables. L’élaboration de ces modèles n’a constitué pour le Collège régional de Prospective de Wallonie, qu’une étape, un moment, dans une réflexion prospective qui le portait vers l’établissement d’un processus de transformation, en définissant des axes stratégiques et des actions pilotes permettant aux différents acteurs-cibles de passer d’un système à l’autre. Cela tout en tenant compte de cette transition déjà en marche dans certains secteurs ou chez certains acteurs de la société wallonne.
Le projet wallon, tel qu’il avait été reformulé par André Renard, Fernand Dehousse, François Perin et d’autres lors du lancement du Mouvement populaire wallon, cinquante ans auparavant, le 27 mars 1961, a partiellement échoué. En atteste notamment le nombre insupportable de personnes sans emploi, sous le seuil de pauvreté ou en situation d’illettrisme. Le projet wallon a également échoué, car il n’a pas été capable de créer et encore moins de maintenir la confiance en la Wallonie, celle des acteurs wallons entre eux et celle en l’avenir. La confiance, c’est le maitremot de la Déclaration de Politique régional du 22 juillet 2014, ce qui pourrait augurer d’une logique de dialogue et de contractualisation avec les acteurs, une politique respectueuse et ouverte, telle qu’Elio Di Rupo l’avait dessinée, en 1999, avec le Contrat d’Avenir pour la Wallonie.
v Analyse 15
Philippe Destatte,
Cinq enjeux majeurs pour la législature wallonne
16 septembre 2014,
20.621 signes.
Un projet pour la Wallonie, c’est l’exigence partagée de plus de démocratie et d’un meilleur développement, a-t-on souvent souligné. Pour y parvenir en 2014, il s’agit de répondre à des enjeux dont le niveau de priorité est souvent variable en fonction des acteurs mais aussi des moments, les processus de dramatisation leur échappant parfois. En se basant sur les travaux menés par le Collège régional de Prospective
de Wallonie depuis 2011, notamment la réflexion prospective Wallonie 2030, on pourrait retenir cinq enjeux majeurs pour la nouvelle législature wallonne 2014-2019 : la création et croissance des entreprises, l’adéquation de la formation au développement régional, la refondation de la fonction publique, la trajectoire budgétaire, l’articulation des territoires au projet régional. D’autres enjeux que les cinq évoqués ici attendent bien entendu la Wallonie : tant les réalités quotidiennes que l’Europe seront là pour les rappeler. Le renforcement de la cohésion et de l’inclusion sociales, l’accès aux droits fondamentaux des citoyens, les défis environnementaux et énergétiques, y compris le changement climatique, le vieillissement de la population, la coopération européenne, la responsabilité qui est la nôtre à l’égard des pays en moindre développement, seront aussi à l’ordre du jour de la nouvelle législature. La Déclaration de Politique régionale ne les néglige pas. La manière avec laquelle l’ensemble de ces enjeux sera pris en charge contribuera – ou non – à (re)construire la confiance, qui est l’un des leitmotive du MinistrePrésident Paul Magnette. La réalisation d’un Pacte qui donne un sens et un horizon, au-delà des divisions dépassées et des querelles intestines, constitue, avec le renforcement du rôle du Parlement wallon et une participation plus active des citoyens à la vie publique, la clef de la réussite.
v Analyse 16
Philippe Destatte,
Le Nouveau Paradigme industriel : une grille de lecture
19 octobre 2014,
20.923 signes.
Il est classique, surtout en période de difficultés ou de tensions économiques d’entendre dire ou de lire que la crise n’est pas conjoncturelle mais qu’elle constitue une transformation de structure de l’économie ou de la société. On évoque alors le changement de paradigme. Après une explication des trois mots qui composent le concept de « Nouveau Paradigme industriel », nous nous attardons sur les trois grandes mutations qui structurent le début du XXIe siècle. La première mutation est l’approfondissement et l’extension du paradigme né de la Révolution industrielle. Toute notre société reste très largement sous-tendue par la société industrielle et continue de s’y inscrire largement, contrairement à ce que certains pensent. Ce système complexe est né d’une mutation globale. Il a connu de nombreuses vagues d’innovation, différents régimes politiques et sociaux, mais tous ces changements n’ont pas affecté l’essence de son modèle. La seconde mutation, observée depuis la fin des années 1960, est que nous vivons actuellement la révolution cognitive, qui affecte l’organisation de tous les domaines de la civilisation, tant la production que la culture, en s’appuyant sur les changements nombreux qu’induisent l’informatique et la génétique, en considérant l’information comme infinie ressource. L’élément majeur de cette mutation est la convergence entre, d’une part, les technologies de l’information et de la communication, et d’autre part, les sciences de la vie. La troisième mutation, voulue celle-ci, est que nous construisons une nouvelle harmonie au travers du Développement durable. Cette mutation est née de la contestation de la modernité, de la critique de la société industrielle, des programmes des Nations Unies pour l’Environnement ainsi que de l’expérience humaine générée au fil du temps par les catastrophes écologiques. C’est l’ensemble de nos politiques économiques, la gestion de toutes les entreprises, dans tous les domaines de l’activité humaine qui ont été revus, en y intégrant le temps long. Ces trois mouvements constituent le Nouveau Paradigme industriel dans lequel nous œuvrons et œuvrerons encore durant quelques décennies.
v Analyse 17
Philippe Suinen,
Les services publics ont la responsabilité de stimuler au mieux la relance et l'emploi,
19 novembre 2014.
v Analyse 18
Philippe Destatte,
Prospective, société et décision publique en Wallonie
Conclusion du Colloque du même nom, organisé au Parlement wallon, le 27 novembre 2014,
20.829 signes.
Lors du colloque intitulé « Prospective, société et décision publique », organisé au Parlement wallon, à l’occasion du 10e anniversaire du Collège régional de Prospective, celui-ci a souhaité donner la parole aux acteurs et les faire réagir à quelques idées qui lui tiennent à cœur tout en se stimulant, se bousculant, par la présence de regards distanciés, mais non distants : ceux du Nord – Pas-de-Calais, de la première des institutions européennes en matière de politique régionale – le Comité des Régions – et d’Eddy Caekelberghs, journaliste, chargé de l’animation des tables rondes. En conclusion de ce colloque, nous avons abordé la problématique des rapports entre la prospective, la société et la décision publique en Wallonie, en intégrant la réflexion des différents intervenants, au travers de quatre interrogations : en quoi la prospective est-elle utile ? Pourquoi la confrontation avec le Nord – Pas-de-Calais est-elle si stimulante ? Où voulons-nous aller ensemble ? Comment faire atterrir les travaux entamés par le Collège
régional de Prospective de Wallonie ? La prospective est un processus continu, orienté vers l’action en vue de rejoindre une vision, par l’implication des acteurs. Elle est une manière de penser, de travailler et d’agir, qui se fonde sur au moins trois intentions : intégrer le long terme (plus le temps est long, plus nous pouvons disposer de marges de manœuvre pour proposer des alternatives crédibles), épouser la complexité du système (la prospective intègre toutes les dimensions – économique, sociale, démographique, culturelle ou d’environnement – dans une approche holistique et systémique), mener à la transformation, au changement par l’action (l’utilité de la prospective réside dans sa capacité de nous projeter dans le futur pour agir sur le présent en fonction non seulement de ce qu’on y a vu, mais de ce qu’on y a inscrit de nous-mêmes). Les travaux du Nord – Pas-de-Calais ont montré la nécessaire connexion et l’indispensable cohérence entre une approche de redéploiement économique, l’aménagement et le
développement territoriaux, une stratégie de développement durable et une logique d’interterritorialité. Le moment est particulièrement propice au développement de la prospective. Une vision claire de notre avenir doit être définie collectivement avec l’ensemble des acteurs wallons. L’implication des acteurs dans la réflexion sociétale passe évidemment par leur reconnaissance, par l’intelligence collective, la co-construction, productrice de politique mais aussi d’action publiques, tout en s’appuyant sur le politique pour que ce soit lui qui donne le ton, impulse le mouvement, organise la réflexion et l’action, car c’est sa responsabilité. La dynamique de la prospective, adéquatement inscrite dans la gouvernance permet que les élus ne soient pas seuls à imposer le changement mais qu’ils l’inscrivent dans un mouvement collectif. Dans le dialogue que le président du Parlement wallon, André Antoine, appelle à ouvrir avec les acteurs de la prospective, l’Institut Destrée est évidemment partie prenante.
v Analyse 19
Philippe Destatte,
Cinq défis de long terme pour rencontrer le Nouveau Paradigme industriel
31 décembre 2014,
37.323 signes.
Le Nouveau Paradigme industriel dans lequel nous évoluons en ce début de XXIe siècle est porteur d’au moins cinq défis de long terme, que nous avons formulé sous forme de questions : comment renforcer l’industrie avec les innovations de la Révolution cognitive ? Comment pouvons-nous appliquer les principes de l’économie circulaire à toutes les activités de la chaine de valeur pour aboutir à un modèle sans
déchet dans l’industrie de l’avenir ? Comment pouvons-nous réduire la consommation d’énergie afin d’améliorer la compétitivité de l’industrie ? Comment pouvons-nous préparer les différents acteurs, et en particulier les entreprises, à l’économie sans carbone ? Comment peut-on construire un réel partenariat entre politiques, société civile et entreprises pour créer une gouvernance multiniveaux positive et dans laquelle tous sont gagnants ? Toutes ces questions sont largement présentes dans la pensée prospective et stratégique européenne en tant qu’enjeux identifiés. Ce qui est essentiel pour les acteurs qui travaillent à rencontrer ces défis, c’est de rechercher, avec précision, quels processus et quels mesures ils doivent élaborer, année après année, afin d’y répondre concrètement et de manière décloisonnée.
Décrire aujourd’hui le Nouveau Paradigme industriel, s’interroger sur ce qu’est l’industrie en ce début du XXIe siècle prend tout son sens, dès lors que, face aux mutations présentes et futures, il faut pour le monde, l’Europe, chacun des 27 et chacune de leurs régions, définir des politiques industrielles. L’objectif principal d’une politique industrielle consiste à anticiper le changement structurel, le rendre possible
en levant les obstacles et en corrigeant les erreurs du marché. Dès lors, la prospective a sa place dans la préparation et la définition de la politique industrielle. Tant au cœur des entreprises qu’aux différents niveaux de gouvernance.
v Etude 1
Philippe DESTATTE,
La prospective en Wallonie, réalisations concrètes et occasions manquées
16 mai 2014,
66.203 signes.
Ce texte trouve son origine dans l’intervention que Philippe Destatte a donnée lors du colloque de la Société wallonne de l’Evaluation et de la Prospective (SWEP), organisé à Louvain-la-Neuve, le 15 mai 2014. Sous le titre « L’évaluation et la prospective en Wallonie et à Bruxelles : trop de consensus, pas assez de controverses ! », la SWEP regrettait que les contraintes budgétaires et les modes de gouvernance ont souvent davantage privilégié la réflexion à court terme que le choix de modèles de transition inscrits dans le long terme. Malgré la qualité parfois remarquable des démarches initiées, l’appropriation régionale est faible et le lien à l’action, invisible. Philippe Destatte distingue trois périodes – une première période de limbes de la pensée prospective wallonne (1976-1986), une deuxième d’émergence de la prospective régionale (1986-2004) et une troisième période de consolidation chaotique (2004-2014) – pour chacune desquelles il identifie les principaux acteurs wallons dans le domaine de la prospective, les initiatives et réalisations concrètes en la matière, les collaborations et synergies, mais aussi les occasions manquées et les désaccords entre les différentes parties prenantes, avant de livrer, pour conclure, un regard contrasté sur la prospective en Wallonie.
v Etude 2
Philippe DESTATTE,
L'économie wallonne : les voies d'une transformation accélérée
3 novembre 2014,
42.132 signes.
Ce texte trouve son origine dans l’intervention que Philippe Destatte a donnée au Forum financier de la Banque nationale de Belgique, le 3 novembre 2014. Le directeur général de l’Institut Destrée a articulé son exposé en trois points. Le premier pour rappeler que, si nous sommes bien sortis du déclin, la situation de la Wallonie appelle bien une transformation accélérée. Le deuxième pour évoquer quelles pourraient être, selon lui, quelques-unes des voies de cette transformation. Le troisième pour conclure sur l'idée d'une nouvelle bifurcation. Malgré les efforts qu’ils constituent, les sept plans stratégiques de redéploiement
économique – Déclaration de Politique régionale complémentaire de 1997, Contrat d'Avenir pour la Wallonie de 1999-2000, Contrat d'Avenir actualisé de 2002, Contrat révisé en 2004, Plan Marshall de 2005, Plan Marshall 2.vert de 2009, Plan Marshall 2022 de 2012 – ont probablement permis de stabiliser la région, mais pas de diminuer le différentiel avec la Belgique. À ceux-ci s’ajoutent encore les programmes
d'actions portés par les Fonds structurels européens, mais la Wallonie reste sous la barre des 75 % du PIB belge depuis les années 1990. C'est le cumul de la faiblesse de la productivité et le bas niveau du taux d'emploi (84 % de la moyenne belge) qui continuent à handicaper le PIB par habitant en Wallonie. En l'état, la Déclaration de Politique régionale 2014 permet de continuer à stabiliser l'économie wallonne, de poursuivre le redéploiement mais non de le réaliser dans des délais raisonnables. C’est pour cela qu’il faut impérativement considérer les voies d'une transformation accélérée. Ce redéploiement de la Wallonie passe nécessairement par une volonté de considérer, puis de surmonter les cinq freins au développement wallon identifiés par Christophe De Caevel (à savoir la croissance des entreprises, la territorialisation des politiques, la valorisation des recherches, la gestion de l'espace et l'enseignement technique et professionnel) et par des moyens financiers supplémentaires. Ce que la Wallonie doit trouver, c'est le chemin d'une nouvelle bifurcation. Celle-ci permettra d'optimiser son système régional d'innovation. Nous constatons en effet encore et toujours l’existence de deux Wallonie : l’une qui se reconstruit, se diversifie et développe ses nouveaux pôles innovants et créatifs, et l’autre qui poursuit inéluctablement son affaissement. Dès lors, il est nécessaire de s’interroger sur les voies d'une transformation accélérée, c'est-à-dire qui permettrait d'activer une renaissance régionale dans des délais qui répondraient sans retard aux enjeux auxquels sont aussi confrontés la Belgique, l'Europe et le monde.
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique

Photo d'entête : Yves Goethals, Congrès "Bifurcations", Namur, 04.12.2018. (c) Institut Destrée, Droits SOFAM
![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() @InstitutDestree
@InstitutDestree![]() www.linkedin.com/company/destree-institute/
www.linkedin.com/company/destree-institute/ ![]() Webmail de MAD-Skills.eu
Webmail de MAD-Skills.eu
![]()
(c) https://www.institut-destree.eu, en ligne depuis 1996,
ONG partenaire UNESCO et UN-ECOSOC depuis 2012
Propulsé par  hébergé par wistee.fr
hébergé par wistee.fr